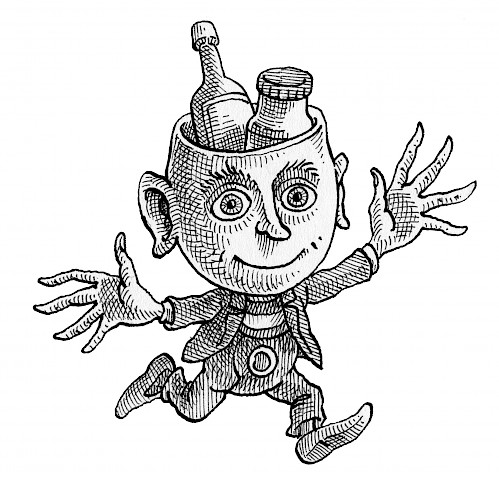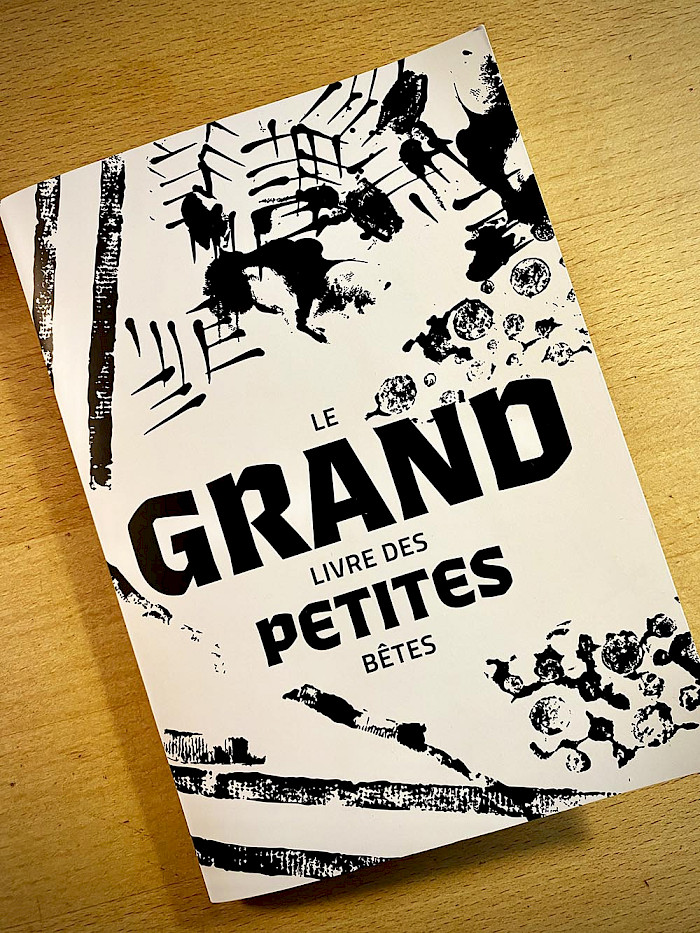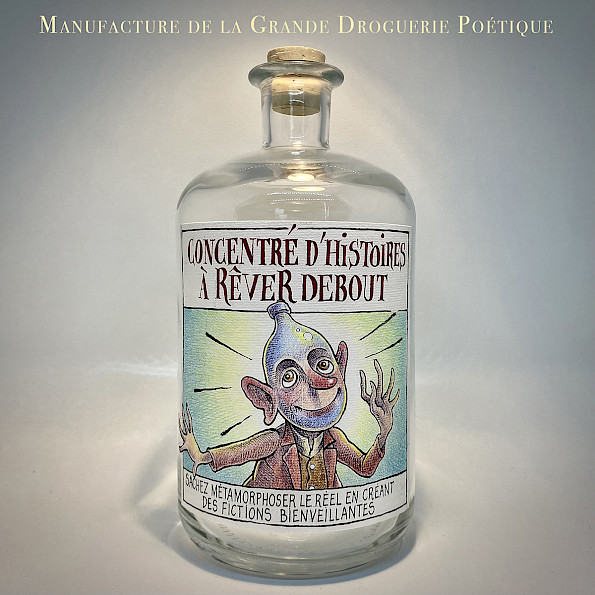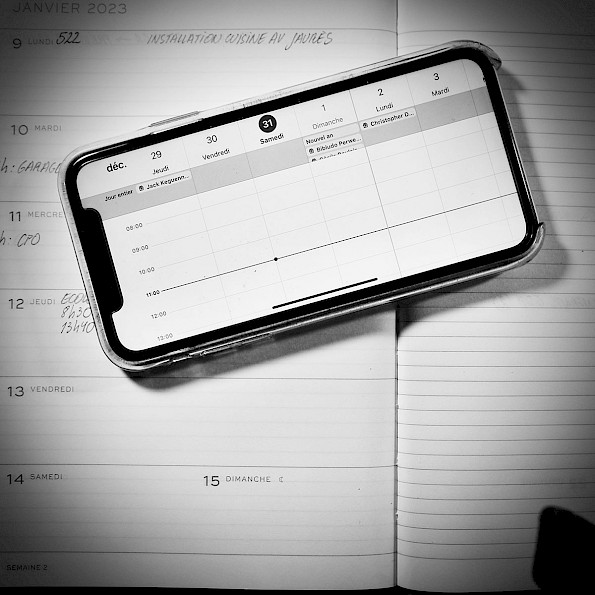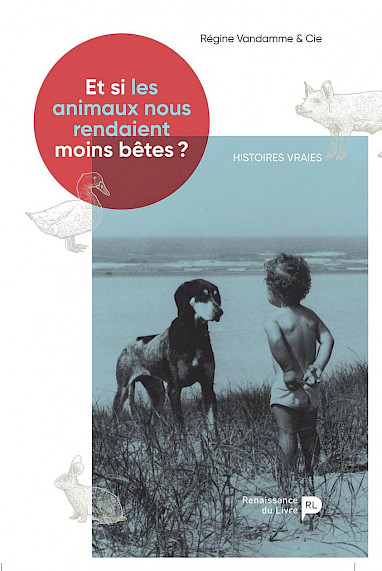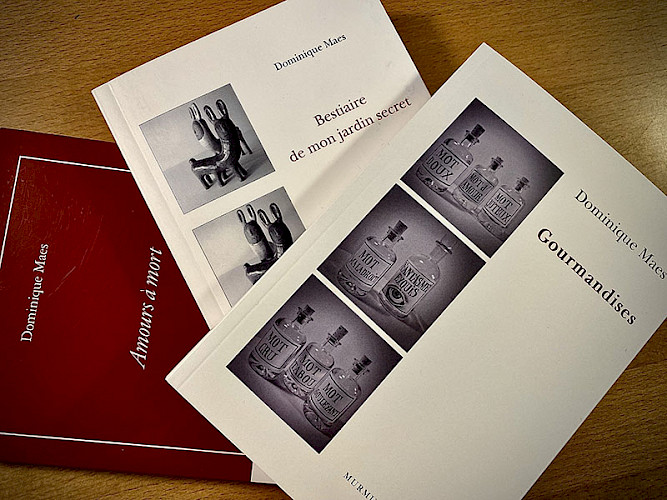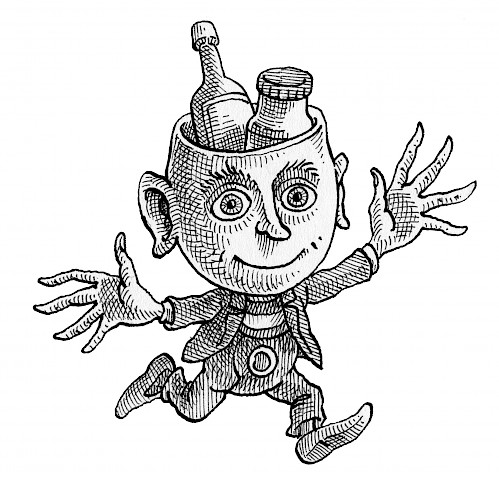Une préface d'un livre précieux — 08/07/2025
Petit bonheur à partager, la publication d'un livre à petit tirage qui est né dans une école près de Cahors, en France. Quelque chose se passe là-bas avec les amis qui y travaillent. Les enfants y ont créé des bestioles imaginaires, j'ai écrit des poèmes pour les accompagner et puis la préface que je vous livre ici : elle contient de l'essence de conviction. Bonne dégustation.
Les lendemains qui enchantent se préparent doucement, loin des discours pompeux, des rodomontades et des marchands du grand commerce international qui aimeraient tant que nous ne soyons plus que consommateurs consumant jusqu’à notre propre conscience.
Cela commence dans une cour d’école. On y sème des graines d’humanité, on arrose avec tendresse, on soigne par l’empathie et par l’exigence bienveillante. C’est un travail très patient de poète-jardinier, de pédagogue du terreau qui sait garder les pieds sur terre en contemplant les étoiles qui scintillent dans les yeux des enfants et parfois, le désarroi qui fait chavirer le regard des parents.
Il faut distiller chaque jour des doses de poésie et de l’essence d’imaginaire en favorisant l’éveil des consciences. Pardi ! C’est qu’ils vont en avoir besoin, les mômes, pour trouver des solutions nouvelles dans ce monde en souffrance qu’on va leur laisser. Mais j’ai confiance en eux. Ils vont tracer leur chemin. La vie d’ailleurs crée toujours de nouveaux sentiers. Ce sont eux qui vont les défricher. D’autant plus qu’ils auront acquis les outils nécessaires dans cette petite école de Lamagdelaine que j’aime tant, où les enseignant-e-s qui y travaillent avec tant de passion et d’amour les leur transmettent. Ils y acquièrent les bases si essentielles qui construisent notre humanité : le goût des mots qui permet de penser, la curiosité pour toute chose, la musique des mathématiques, l’art d’apprendre qui conduit au véritable plaisir et le tissage social où les différences s’entremêlent pour créer une société digne.
Je n’idéalise rien. Je sais que nait ici cette culture qui nous conduit à se sentir joyeux d’être un être humain en ayant conscience de ne l’être jamais assez.
Soignons donc patiemment les rhizomes qui nous réunissent. Ils sont de plus en plus solides, rampent bien au-delà des frontières, traversent les murs d’indifférence, résistent au cynisme, à la morbidité et aux soubresauts violents des vieux systèmes patriarcaux qui s’effondrent.
La vie palpite dans nos alliances et nos complicités créatives.
Ce petit livre où grouillent d’improbables bestioles imaginaires est le début d’une réévolution douce.
Avec toute mon affection,
Dominique Maes
Camelot Poète et Président Directeur Généreux de la Grande Droguerie Poétique
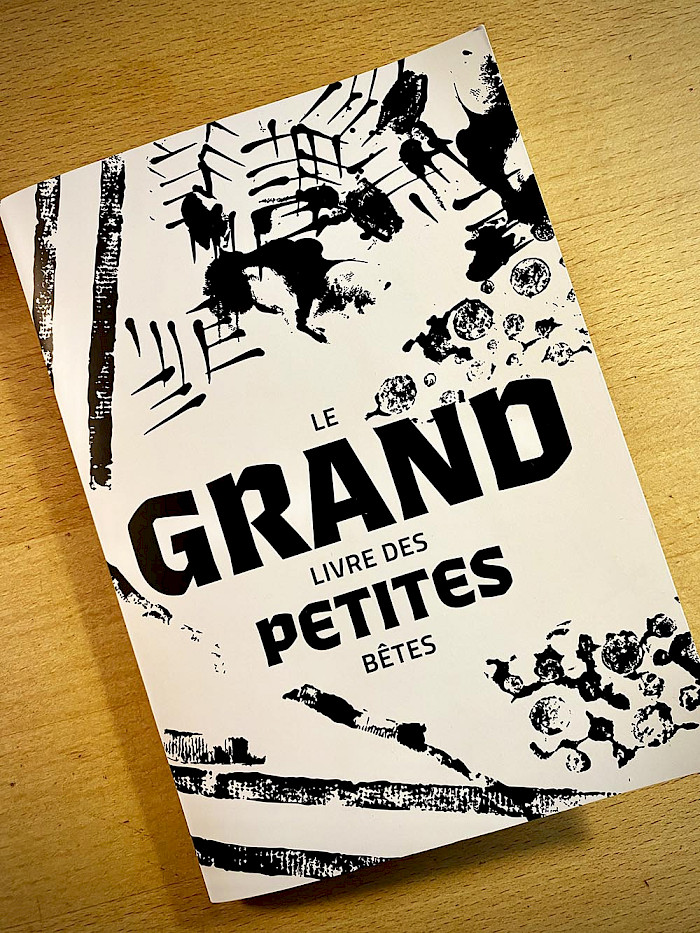


Chronique poétique du quotidien 34 — 21/03/2025
Cette chronique a été publiée par la cellule Epicure, Etudes Pédagogiques Internationales et Culturelles de Recharche et d'Echanges.
Éloge du cabinet de curiosité
Cela commença lorsque j’étais un petit enfant étonné d’être vivant et jouant sur la plage d’Ostende ou contemplant le sentier qui se perdait dans la pinède, derrière la maison de mes grands-parents.
Il y avait là des milliers de coquillages aux formes étranges, usés par la mer qui les avait roulés et polis sur le sable abrasif. Il ne restait parfois d’eux qu’une simple et splendide spirale que je rangeais au fond de ma poche où elle retournerait bientôt à la poussière.
Il y avait ici des insectes minuscules et somptueux à la carapace iridescente ou ces longues cohortes de fourmis affairées portant des charges colossales. J’aimais perturber leur procession par la chute d’une brindille et observer la nouvelle formation de leur trajectoire mécanique.
Cela se poursuivit plus tard par des collections improbables, des accumulations d’objets, un goût pour le bizarre, pour les disques anciens, par les livres qui continuent de m’envahir, par la découverte de musées, de pays et de personnes dont chacune contient une histoire singulière qu’elle ne demande qu’à raconter.
Le monde est un splendide et infini cabinet de curiosités.
Mais je dois une sorte de révélation au Musée du docteur Spitzner qui rassembla des curiosités anatomiques parfois douteuses dans le but d’éduquer et de terrifier les classes laborieuses, fascinant surtout les surréalistes belges qui visitèrent sa collection installée tous les ans au milieu de la Foire du Midi, à Bruxelles. En ce temps-là, on exposait aussi les monstres, un mouton à cinq pattes et la plus grosse femme du monde.
Et si je ne sais (mais je suis curieux !) où sont entreposées aujourd’hui les statues de cire si épouvantablement réalistes, les bocaux contenant des fœtus monstrueux, les têtes réduites ou la grande peau humaine tannée, je suis certain que ce cabinet de curiosité là a contribué à l’envol de mon imaginaire.
Devenu aujourd’hui Président Directeur Généreux de la Grande Droguerie Poétique, premier magasin de produits qui ne se vendent pas mais qui distillent de l’essence d’essentiel en accumulant les idées fioles, je reconnais et rend hommage à tout ce qui m’a précédé et que je suis toujours aussi curieux de découvrir encore. Car si cela aura une fin – je ne suis pas dupe de mon désir d’immortalité qu’exprime la collection - je ne serai jamais rassasié.
Vous non plus, curieux que vous êtes puisque vous me lisez !
Vous fréquentez avec délectation ces musées dont les origines furent souvent les collections singulières de quelques honnêtes ou plus farfelus hommes des siècles passés. Même le British Muséum s’enracine dans les collections botaniques de Sir Hans Sloane.
Ne frissonnez-vous pas dans ces petits musées d’une province oubliée où des objets dont l’usage ne nous est plus connu émeuvent par le poli de leur manche si souvent manipulé par l’artisan ? N’êtes-vous pas rêveurs devant quelques amulettes et talismans, produits par d’antiques superstitions ? N’êtes-vous pas fascinés par ce joli meuble du XVIIIe siècle, chef-d’œuvre d’un ébéniste virtuose qui témoigne de la passion d’un petit marquis pour les choses de la Nature ? Et de la même façon, ne courrez-vous pas vers ces expositions d’art contemporain qui n’est, après tout, qu’un chantier permanent de curiosité exacerbée ?
Si ce n’est pas le cas ou si vous désirez encore fortifier cette qualité qui fait de nous des humains (n’allez pas me dire que c’est un vilain défaut !), nous vous recommandons l’utilisation quotidienne de notre Cure de Curiosité. Elle provoque bien évidemment de magnifiques effets secondaires : ouverture du cœur et de l’esprit, passion scientifique autant que poétique, joie de vivre et appétence vivifiante, empathie et soif inextinguible des diversités culturelles.
Dans ce monde où quelques-uns voudraient réduire et museler les imaginaires susceptibles de trouver d’indispensables solutions nouvelles nécessaires à nos prochaines adaptations, il est vital de redécouvrir, créer et multiplier les petits et grands cabinets de curiosité.

Chronique poétique du quotidien 33 — 24/01/2025
La beauté
Dans tout ce tohubohu, ces tracas, ces tralalas, ce brouhaha, nous ne la voyons pas. D’autant plus que des malotrus ont un mauvais goût si puissant qu’ils lui font écran. Quittons donc leurs médias médiocres et pour ne pas être davantage à cran, fermons la boite à images si peu sage. Ouvrons les yeux, les mains, les narines, le cœur, enfilons nos godasses, prenons le chemin de traverse, le sentier qui serpente, la bonne pente (quittons la mauvaise !), et retrouvons le bon sens de nos cinq sens.
Ça y est ? Vous respirez ? Prenez un peu de repos et goûtez le rythme de mes mots. Je vous sens encore inquiet. Le manteau noir du désespoir s’accroche à vous. Avec douceur, mais fermeté, nous allons le déchirer, le tailler en haillons qui s’accrochent, mais s’effilochent. Faisons-lui les poches.
Il ne s’agit pas de refouler la moindre chose. Touillons dans la poussière la plus amère et éveillons-nous en la lançant dans la lumière. Ce sera notre façon de résister à ce qui veut nous aliéner et nous immobiliser dans la terreur.
Vous avez vu ? C’est déjà très joli, cette poussière qui scintille. Voilà l’amorce du remède, une spécialité de poète : l’émergence incongrue d’un premier émerveillement. Il suffit de savoir la capter même dans la pire des calamités, catastrophes, génocides, triomphes de la bêtise avide. Nous allons souffler sur les braises d’un futur feu de joie.
Bien sûr, palotins, sinistres ministres, enfant président et sbires ubuesques ont l’air de prendre du pouvoir, ivres d’orgueil, fiers de leur vulgarité proclamée, de leur absence d’élégance, de leur violence assumée, mais ils ne sont gonflés que par l’importance que nous leur donnons. Reprenons notre souffle et ils ne tarderont pas à dégonfler, la panse crevée par la réalité qui, tôt ou tard, annihilera leurs rodomontades et les feront débouler de leur piédestal et de l’illusion du pouvoir.
Ah ! Le pouvoir ! C’est que l’humanité n’en a pas encore fini avec cette maladie-là. Il faudrait qu’elle se soigne avant que cette infection ne lui fasse la peau. À force de vouloir imposer sa domination à son chien, au voisin, à sa femme, à la terre, à la mer, à l’espace, le vieux guerrier obsolète, l’enfant gâté et même pourri qui n’a pas de limite, crèvera en entrainant les autres, dans le désert morbide que son avidité aura engendré.
À moins que… nous n’ouvrions les yeux, les mains, les narines et le cœur, que nous enfilions nos godasses et prenions enfin le chemin de traverse en retrouvant le bon sens de tous nos sens et les trésors du corps. Ce n’est pas difficile. C’est à portée de main ou de l’œil ou du pied. Il suffit de s’arrêter un instant. Et de la contempler.
Elle est là, la beauté : dans la rue, au fond du jardin enneigé, dans des petits riens ou des opéras grandioses, dans une seule note, un seul son ou toute une symphonie, dans la voix sublime d’une femme qui n’est plus ou dans le murmure suave de celle qui est si vivante, dans le dessin qui fut tracé dans un instant de vie et dans le trait qui n’est pas encore advenu, dans le tableau qui a traversé des siècles et dans celui qui n’a jamais été achevé, dans le mot tu qui sera dit un jour et dans la phrase qu’on gardera pour soi, dans le vol calme d’un oiseau de passage, dans la lumière du matin qui vient caresser ton visage, dans un sourire, dans un grand rire, un tout petit baiser, dans l’animal qui te fait confiance, dans la complicité d’un ami qui te comprend lorsque tu restes muet, dans la lettre que tu reçois, dans le moment qui jaillit spontanément ou après des années d’apprentissage, dans l’instant parfait que tu ne connais pas encore, mais où tout se sera mis en place pour que tu la perçoives enfin et qu’elle jaillisse en t’éclaboussant de lumière.
Marche vers la source qui ressource.
Nous ne sommes pas en bout de course.

Chronique poétique du quotidien 32 — 10/01/2025
Ah ! Comme il est joli, mon petit pays : tout en nuances de gris, des gammes infinies de pluies, des habitants réjouis, un peu endormis, évitant les ennuis en grands spécialistes des compromis. Et voilà qu’un des palotins des phynances, roquet insolent et carnassier — il en existe d’autres qui pratiquent comme lui la politique en hystérique —, vient perturber notre basse-cour faisant caqueter, entre autres, les gens de plume. Il s’agite et aboie dès qu’il le peut ses slogans indigents que s’empressent d’amplifier des médias obsédés par l’augmentation de leur taux d’écoute. Il nous mordille les chevilles pendant la sieste et vomit finalement sa haine de la culture sur nos tapis. Malappris.
Il aime surtout et avant tout que l’on parle de lui à n’importe quel prix, sachant que comme pour un produit de lessive, il faut clamer son nom le plus souvent possible pour qu’on le retienne lorsque nous ferons nos petites commissions aux prochaines élections.
Et puis il n’apprécie guère que la culture et l’éducation soient populaires, encore moins lorsqu’il s’agit de les rendre permanentes, préférant la petite musique lénifiante d’une pensée unique travestie en spectacle permanent du grand divertissement. Fermons l’écran.
Et sachons le laisser gigoter en pantin désarticulé en prenant l’habitude de ne le point nommer. Pas la peine de lui faire cet honneur. Vous imaginez sa rage, lui qui aime tant le tapage. Abandonnons-le dans les oubliettes de sa médiocrité sans pour autant, ne serait-ce qu’un instant, croire à la supériorité des cultureux dont sans doute, nous faisons partie.
Mais parlons-en de la Culture avec un grand Cul. Pour qui se prend-elle depuis si longtemps ? N’a-t-elle pas fini par lasser trop de gens avec ses grands airs et son obscure prétention qui cache souvent sous ses discours abscons un vide abyssal ? N’a-t-elle pas préparé le propos rageur et dressé d’une certaine façon le roquet auquel nous faisons ici allusion ?
Il est temps qu’elle comprenne sa multiplicité et son polymorphisme et ne se retrouve pas confinée, confisquée par quelques prétentieux à l’indignation facile qui ronronnent en circuit fermé.
Nous préfèrerions fêter le pluriel des cultures qui s’entrecroisent, fusionnent parfois, s’enrichissent par des origines multiples. Elles doivent se défendre d’être figées en une seule identité, devenant l’étendard du pouvoir dominant et rester modestement en mouvement permanent, indispensables comme la vie.
S’il le faut vraiment et cela peut être utile pour résister à l’abêtissement orchestré par les palotins du libéralisme dont notre gigoteur est la caricature, il est temps de faire vivre et palpiter le ministère permanent des cultures. Pas la peine de les enfermer dans un immeuble labyrinthique où elles seraient asphyxiées. Elles doivent être animées et vivifiées par chacun de nous. Ouvrons les oreilles, déplaçons-nous, régalons-nous, écoutons-nous, causons, chantons plus fort, dansons encore comme nous le voulons, imprimons les p’tits papiers, faisons vibrer les murs. Il n’y aura jamais assez de cultures. Bienvenue dans l’aventure.

Chronique poétique du quotidien 31 — 02/01/2025
C’était bien. Chaleureux et un peu fou comme il se doit. Nous avons su rester presque raisonnables, mais nous nous réveillons quand même légèrement brumeux et en décalage horaire pour le premier jour de l’an.
Nous avons traversé le réveillon avec de vieux amis et quelques inconnus qui se sont rajoutés au groupe. Nous nous sommes serré les coudes et tenu les côtes à s’en décrocher les mâchoires. Et le temps a passé. Il passe tellement vite, ce salaud.
C’est pourtant lui que nous avons fêté en nous promettant que l’année sera belle et bien bonne dans sa nouveauté proclamée en feu d’artifice. Nous nous sommes souhaité le meilleur à commencer par la santé. C’est banal, mais cela ne peut pas faire de mal, surtout à l’ami que nous savons malade, mais auquel nous n’avons demandé aucune précision pour ne pas risquer de gâcher la fête.
Et nous avons bu, un peu plus que d’habitude, le cœur au chaud, la tête pleine de paillettes, le corps enguirlandé par la musique. Nous avons dansé, même celles et ceux qui ne le savent pas.
Ce matin, nous nous retrouvons sur la route. Éberlués, nous la reconnaissons. C’est la même qu’avant. Nous marchons plus ou moins vaillamment et l’air piquant fait du bien. Il nous remet les idées en place et permet d’éliminer les toxines. Aujourd’hui, nous déjeunerons d’un repas léger, nous boirons de l’eau, nous éviterons encore d’écouter les informations, mais nous penserons avec une pointe de culpabilité au génocide en cours, aux humains sacrifiés par les serviteurs de Thanatos, aux solitudes effroyables et égoïstement à tout ce qu’il nous faut prochainement résoudre. Nous nous contenterons d’envoyer quelques messages à ceux qui tiennent vraiment à nous la souhaiter bien bonne.
Nous savons très bien que rien n’a changé, que nous poursuivons le chemin construit par ce qui précède et par les prochaines péripéties de notre vie, les bonnes et mauvaises rencontres, les joies et les peines, les passions et les peurs, les enthousiasmes et les désillusions, les hasards des complicités, la ferveur des indignations… Peut-être la vie nous attend-elle au tournant ? Ce sera bien. Ce sera pire. Ce ne sera peut-être rien ou nous atteindrons les illuminations des instants de grâce.
Nous marchons. Nous nous souhaitons la bonne année et nous jouons le jeu.

Chronique poétique du quotidien 30 — 29/11/2024
Chronique du réel écrite à partir d’une de mes nombreuses rencontres « PECA » - Parcours d’Éducation Culturelle & Artistique (Fédération Wallonie Bruxelles) - dans une école de Bertrix en Belgique.
Cherchant son souffle, il tentait de surnager dans mon flot de paroles. Je le percevais du coin de l’âme. Il s’accrochait bravement, un grand sourire en guise de bouée. Mais je voyais bien qu’il allait être bientôt submergé. En bon camelot poète, je me devais d’endiguer et de canaliser. Je ralentis le débit des mots émus.
Je trouvai le rythme pour brasser les idées qui se bousculaient, entraînées dans le courant de l’intervention poétique. Ce n’est pas tout de jeter des bouteilles à la mer, de croire aux messages et à l’essence de sens, il faut aussi capter les SOS que certains naufragés vous retournent.
C’était un grand gaillard qui dépassait d’une bonne tête ses condisciples. Cheveux blonds et courts, bras musclés, un homme déjà parmi les gamins. Rescapé ukrainien, il s’était échoué ici, dans cette ville ardennaise si paisible. Il apprenait le français et reprenait des études dans une école où les adolescents de son âge sortaient à peine et avec prudence de l’enfance. Son accent était rugueux, ses phrases maladroites, mais il dégustait mes paroles avec une attention soutenue et captait parfois avec un peu de retard mes métaphores saugrenues qu’un camarade dévoué tentait discrètement de lui clarifier. Et il riait comme les autres de mes produits imaginaires et de mes potions pataphysiques tragi-comiques. Devenant soudain sérieux, son regard me faisait comprendre qu’il avait déjà encaissé une bonne dose d’absurdité de ce monde et sans doute pire, puis ses yeux à nouveau enfantins pétillaient devant un flacon rempli de jolis sentiments.
Et c’est avec un sourire au coin des lèvres qu’il se mit immédiatement au travail lorsque je proposai à chaque élève de créer à son tour la ou les potions imaginaires qu’il aimerait utiliser quotidiennement pour sublimer le réel, résoudre les problèmes ou tout simplement sauver la planète. Je recommandai encore la distillation d’une dose de joie, excellent remède pour résister à tout ce qui nous voudrait tristes.
Certains pouffèrent et munis de leur téléphone portable cherchèrent l’inspiration stéréotypée, les mots pour la dire et surtout les images croustillantes nécessaires pour jubiler en potaches en provoquant gentiment la prof de français avide de poésie plus élégante, originale et sensible. Mais lui, très concentré, se mit à calligraphier en cyrillique un seul mot. Pas d’hésitation. Il choisit le flacon adéquat, mesura les dimensions de l’étiquette et y imposa son graphisme. Dans sa langue, il traça le mot : « Chance ».
Plus tard, il m’exprima sa joie d’avoir participé à l’atelier et me confia une mission : transmettre son message à celles et ceux que j’allais rencontrer dans ma démarche. Certains viendraient peut-être d’Ukraine, d’un autre pays aussi peu chanceux ou auraient simplement ce privilège d’être nés ici, de rester en vie sans devoir y penser et de pouvoir préparer un avenir tandis que tant d’autres dans le monde sont sacrifiés à des choses qui les dépassent.
J’ai rangé mes bocaux, mes fioles, mes remèdes qui ne sont pas qu’imaginaires.
Je vous en parle et je les apporte dans d’autres écoles, sur d’autres scènes, dans des musées ou je les présente au coin d’une rue, dans mon laboratoire mobile. Je croise des regards perdus, des lueurs d’espoir, des yeux ensommeillés, des sourires goguenards, des bouches un peu blasées, des moues incrédules, des visages surpris, des éclats de rire, des poitrines qui soupirent et s’apaisent, des mains qui applaudissent, des gestes d’empathie. Je reçois de l’enthousiasme en semant les graines d’une révolution douce qui aide à préserver ce qu’il y a de beau en chacun de nous.
J’essaye d’éveiller au moins pour un instant, la conscience que nous sommes en vie et que c’est une chance.

Chronique poétique du quotidien 29 — 22/11/2024
Pour avoir utilisé le bois de plusieurs de ses congénères dans la construction de ma maison, je lui devais bien cela. Il ne faut pas vivre en ingrat. Je l’ai planté dans mon jardin avec ma fille, quant elle était petite. C’est dire si ce fut un instant d’amour. Je sais qu’il l’a senti. Chacune de ses feuilles en frisonne encore.
Je le respecte. Il n’est pas question de le tailler pour le façonner à ma convenance. C’est un hêtre libre. Je ne veux pas limiter son envergure et je le laisse étendre ses branches vers le ciel, plonger ses racines dans la terre. Il grandit bien.
Ma fille a poussé plus vite. Elle quitte de plus en plus souvent le nid pour roucouler ailleurs. C’est la vie, me dit l’arbre dans un murmure. Ne t’en fais pas, vieille branche.
Je vois ma belle oiselle déployer ses ailes. Moi, je perds un peu mes plumes mais je m’accroche à mon panache. Et puis, j’ai cet ami calme, apparemment immobile, et haut en couleur qui me fait comprendre par sa ramure que l’automne est là et que nous pouvons flamboyer encore. Hêtre ou ne pas être. Tout est là.
Il m’offre sa splendeur sereine et me rappelle les cycles de la vie. Ses feuilles vont brunir. Elles formeront son manteau d’hiver. Puis le lent frémissement de ses bourgeons le dépouillera pour faire place à l’insolence printanière et à la crudité d’un feuillage neuf. Moi aussi j’espère être encore vert au prochain printemps.
Je vais suivre l’exemple et me reposer un peu, hiberner tranquille en laissant s’entrelacer mes racines avec celles de la belle dame qui m’accompagne et créer des rhizomes pour aller vers la vie en évitant les os de Thanatos.
Tiens, je sens germer les idées nouvelles. Sous leur cosse, frétillent des pensées précoces. La joie est là, à portée de la main. Je touche du bois, celui de mon ami dont les feuilles d’or frémissent d’émotion. Il faut toujours prendre le temps de caresser un arbre et se fortifier à la source de sa beauté. Santé !

Chronique poétique du quotidien 28 — 15/11/2024
Le mois de novembre s’allonge hors-saison. Il est un peu faux-cul, ni chaud, ni froid, collant et brumeux. Il cache ses intentions. Peut-être n’en a-t-il pas, s’étirant paresseusement vers l’hiver en s’éloignant de l’automne.
Tu crois encore à la promenade somptueuse dans la flamboyante lumière d’octobre qui incendie les feuillages et aux couchers de soleil sur la Mer du Nord qui se maquille en carte postale. Tu t’en vas à Ostende, espérant les émerveillements de Spilliaert et les ensortilèges.
Mais en traversant la ville, tu comprends rapidement que les marchands de chaussures et les chaînes de magasins qui font fabriquer leurs chiffons de luxe en Inde ont exproprié les mystères anciens. Et arrivé sur la digue où il n’y a plus personne, la nuit te tombe sur les épaules.
Tu pourrais faire comme tout le monde : t’abriter derrière une casserole de mauvaises moules, mâcher les frites molles, te cramponner à une table qui tangue dans un bistrot surpeuplé et t’abrutir du brouhaha. Mais tu sens bien que le vent se lève, qu’il faut toujours tenter de vivre et tu refermes ton manteau.
Tu vas marcher, promeneur solitaire, en dédaignant la dernière baraque qui te propose ses churros. Tu es écœuré par l’odeur de friture et la tristesse du marchand. Tu as faim d’autre chose. Tu avances dans la nuit. Tu rentres dans le tunnel. Tu perds tes dernières illusions. Tes poches sont trouées. Mais tu avances. Tu n’attends plus rien, simplement heureux de sentir le travail des muscles de tes jambes.
Sous les réverbères qui ponctuent ton chemin, tu croises de temps en temps l’ombre de toi-même. Elle porte un haut de forme et un grand manteau. Tiens ! Mais le voilà, ton Spilliaert. Les ombres se dédoublent. L’une soulève son couvre-chef. La seconde lui répond poliment.
Tu dépasses le casino. Les jeux sont faits depuis longtemps. Tu rejoins les arcades où résonnent tes pas, la voix de Marvin Gaye et celle d’Arno. Tu boirais bien une bière, mais il n’y a plus ici le moindre estaminet.
Il est temps de descendre sur la plage, de s’enfoncer un peu sur le sable émouvant et de s’immobiliser un instant devant la mer indifférente qui vient mourir paisiblement à tes pieds. C’est le bout du tunnel. Là-bas, à l’horizon, tu distingues une légère luminescence. Cette nuit, des humains désespérés se noieront peut-être en tentant de la rejoindre.

Chronique poétique du quotidien 27 — 01/11/2024
Devenus adultes, nous nous penchons prudemment vers elle. Elle n’est pourtant pas loin, à l’échelle d’une vie, mais déjà on s’en méfie. Nous la regardons de haut. Nous l’avons quittée. Elle a fait son temps. Nous osons même un peu de condescendance, car nous nous prenons désormais très au sérieux en jouant notre rôle dans le théâtre social tandis qu’elle palpite et trépigne toujours en nous. L’enfance se glisse dans nos coulisses.
Jouant très consciencieusement au magasin imaginaire grâce à mes produits poétiques, je la rencontre souvent. Je fais ma tournée des classes, visite des écoles bien différentes de celle que j’ai connue. Je suis fournisseur de culture, de créativité et de poésie pour les jeunes humains qui y sont regroupés. Je redécouvre l’enfance. Et ce n’est ni le paradis ni l’enfer.
L’enfance s’ennuie parfois un peu, prend des coups et s’amuse aussi. Elle a souvent mal au cœur. Elle éclate brusquement de rire et pleure en découvrant son sang perler d’une toute petite écorchure. Elle est blessée plus profondément par une histoire d’adulte qu’elle ne comprend pas. Elle cherche son papa qui a quitté sa maman ou un frère disparu dont on ne lui parle plus. Elle croit que son chien ou sa grand-mère sont montés au ciel, mais se demande si, à la longue, il n’y aurait pas trop de monde là-haut. Elle commence à réaliser que nous sommes mortels, que c’est difficile à admettre et cherche un élixir pour que ses parents ne meurent jamais. Elle se méfie de vous, mais vous fait confiance soudain. Elle vous offre alors une vraie déclaration d’amour écrite avec de magnifiques erreurs d’orthographe et des cœurs roses sur un bout de papier arraché d’un cahier. Elle se fera un peu gronder pour cela. Elle ose dire tout ce qu’on ne dit pas, mais s’enferme parfois dans un mutisme obstiné. Elle vous remet en cause. Elle sait poser toutes les questions qui n’ont pas de réponse. Et puis surtout, elle s’émerveille d’un rien : un petit papier, caillou, bout de bois, carapace, feuille morte qui deviennent trésors poussiéreux au fond d’une poche. Et lorsqu’elle imagine quelque chose, cela devient vraiment vrai.
Quand elle crée à son tour des potions imaginaires, c’est pour transformer l’école ou une sœur ou les méchants comme Poutine. Et les élixirs révèlent un petit garçon qui d’habitude ne dit pas grand-chose, proposent un monde nouveau où règne la paix, sauvent la planète et surtout les animaux de la pollution et de la bêtise des hommes. Mais l’enfance est aussi cruelle et implacable comme la vie. Ne vous y trompez pas ! N’allez pas l’idéaliser par nostalgie. Elle trouve le mot qui fait très mal. Elle balance la critique qui fait mouche pour celui qui manque de confiance. Elle remet en cause la certitude qui vous fait tenir debout. Elle dissout les bonnes intentions. Et puis elle passe l’éponge sur le tableau devenu trop noir.
Alors vient la récréation. Elle abandonne sans hésiter tout ce qu’elle a créé avec tant de concentration pour s’envoler ailleurs avec un grand cri de joie qui résonne dans les couloirs du bâtiment.
Je reste seul dans la classe devenue chantier enchanté. Je range mes flacons et mon matériel de camelot. Il faut reprendre la route qui m’attend.
Je songe à l’enfant que je fus et qui s’étonne toujours en moi d’être là. L’enfance n’est pas éternelle. Elle vous donne des ailes ou vous les brise parfois.

Chronique poétique du quotidien 26 — 18/10/2024
Ce n’est pas rien le travail de camelot poète.
Je pose mes flacons dans la belle bibliothèque après avoir monté les caisses, porté mes valises, surmonté ma fatigue. Je la sens se loger sournoisement entre mes épaules et dans mes pensées qui se bousculent. Il faut reprendre pied. Le public scolaire arrive. Je vais passer ma journée avec des adolescents sceptiques qui, malgré leur méfiance, sont sensibles à mes enchantements et cachent leur petit cœur sous leur blouson caparaçonné.
Brouhaha dans le couloir. Résonance du béton. Rires goguenards et bonjours timides. Vague inquiétude du professeur de français. Je savoure l’amertume du café offert par la bibliothécaire. Et puis, comme le silence se fait, je me jette à l’eau en prenant garde de ne pas nager trop vite. Il s’agit qu’on me suive dans mon tourbillon de paroles. Je brasse les idées pendant une heure, cherche l’instant de grâce, perçois l’éveil d’un émerveillement dans un regard surpris et le rouge d’une joue. Je reprends mon souffle. Pause. Second groupe. Je déjeune. Je ne me tais plus. Je raconte des histoires en grignotant mon sandwich. Je plonge dans de nouvelles anecdotes. J’enchaîne. Nage, papillon ! Et la dernière intervention de l’après-midi se termine.
On ferme. Je recommencerai demain et ce sera différent. Je retrouve ma voiture et l’itinéraire qui me conduit vers ma tanière passagère. L’espace y est réduit à l’essentiel et comme je déborde d’énergie, je ne peux m’enfermer. Je choisis plutôt de marcher dans cette nature qui n’attend personne.
Et me voilà parfaitement seul, hors saison, hors contexte, promeneur incongru en imperméable urbain.
La route est d’abord bordée de quelques rares maisons de vacances aux volets clos, terrasses moussues envahies de feuilles déjà mortes, tables et chaises vermoulues enchaînées de rouille. Dérangées par ma présence, des corneilles croassent leur indignation. Je passe. Je frissonne et descends peu à peu vers la rivière qui chante sourdement. Les arbres et moi l’écoutons respectueusement. L’asphalte craque çà et là, creusé de nids de poule et déformé par les racines qui serpentent sous sa peau. C’est la fin du chemin. Il se termine ici. Dans l’eau. Encore un pas et les tourbillons enlaceraient mes chevilles. Je pourrais me laisser faire, suivre l’invitation perverse d’une Vuivre que j’imagine et devenir esquif, chiffon mouillé qui part à la dérive. Le courant est fort. La rivière m’entraînerait volontiers tout en grignotant cruellement les berges. Ses méandres moelleux me murmurent : « laisse couler, mon ami, laisse couler… ».
Je m’ébroue. Je sens la bonne fatigue m’envahir et la faim me tarauder. Allons, il est temps de remonter la pente.

Chronique poétique du quotidien 25 — 04/10/2024
Tu t’en vas dans la campagne, poussé par ce besoin d’espace et de respiration. Sans doute cherches-tu à ressentir plus intensément que jamais, la vie qui passe et les petits bonheurs. Cours-y vite, ils vont filer, comme disait l’autre.
Il fait un peu plus frais. L’automne se met en place. Il prépare son décor en entrainant quelques feuilles à jouer les mortes. Franchement, elles pourraient faire un effort, s’accrocher encore un peu. Comme toi.
Car Thanatos te bouscule. Tu aimerais bien qu’Éros disperse le tas d’os féroce. Là-bas, à quelques kilomètres à peine de ton petit pays privilégié pour quelque temps encore, il pleut des missiles façon 1984. Les civils ne savent pas très bien où ils vont tomber. Ils cherchent bien à s’éloigner du pire, fuyant vers le nord, partant vers le sud. L’horreur est absurde et ils disparaissent soudain, femmes et enfants, déchiquetés et ensevelis sous les décombres de leur immeuble ou dans les débris de leur camp de fortune. Ils basculent dans l’abstraction d’un reportage ou sont niés dans des chiffres qui dissolvent leur individualité.
Des hommes isolés dans une identité meurtrière meurent aussi dans l’explosion de leur bipeur perversement piégé. L’ingéniosité humaine n’a aucune limite quand il s’agit de faire perdurer ses pulsions les plus archaïques. Désormais, la barbarie est électronique.
Le Grand Macabre frotte ses phalanges décharnées. L’humain est capable de générer son propre charnier.
Et puis, voilà que la nature se déchaîne. Chercherait-elle donc à se libérer de quelque chose ? Il parait qu’elle serait déréglée. Mais c’est peut-être une interprétation bancale de notre espèce anthropocentrée ? La vie n’a-t-elle pas toujours trouvé tout au long de son improbable et miraculeuse existence, une façon de se débarrasser de ce qui la parasite et l’épuise ?
Il faut que tu te calmes. L’essentiel n’est pas d’avoir toutes les réponses, mais de se poser les bonnes questions. D’accord. Mais respire !
C’est déjà un privilège de pouvoir le faire. Tu penses aussi à tes vieux amis. Quelques-uns ne sont plus là. D’autres luttent pour y rester. Toi qui es chanceux, tu promènes tes chiens. Et l’amour te tient éveillé.
Des nuages se séparent. Une lumière incandescente les transperce. Un oiseau surgit des buissons. Ton chien qui ne demande qu’à jouer le poursuit.
Voilà que soudain, une incroyable chaleur t’envahit. Tu laisserais bien jaillir ce sanglot, couler quelques larmes. Tu sens tes jambes, ton ventre, ton sexe. Tout ton corps pense, bien éveillé. Tu as bien compris et c’est ta seule sagesse, que tout ne se passe pas dans la tête. Tes bras, tes mains, ton cœur battant et tes pieds qui exigent la promenade, tes sens exacerbés, te rappellent que tu es vivant. Veinard !
Il est temps de rentrer pour écrire à quelques amis choisis qu’ils le sont aussi.

Chronique poétique du quotidien 24 — 13/08/2024
Chronique poétique d’une villégiature
On part loin de ses habitudes. C’est une chance. On la savoure.
On fait le vide sauf dans ses bagages où l’on a entassé des vêtements inutiles et quelques livres que l’on n’aura pas l’occasion de lire. On se contente très vite de l’essentiel pendant ce temps suspendu. Il fait très beau. La même chemise, le même pantalon seront rincés le soir et portés le lendemain matin. On relira vingt fois le même poème.
On se retrouve, on se ressource dans les collines d’Auvergne, désertées par le tourisme de masse. Il faut marcher dans des sentiers qui n’existent que pour vous. Ces chemins-là ne sont pas faits pour le grégaire. On traverse des villages où dorment des maisons veuves et des magasins sans chalands. Près de la fontaine qui vous rafraichit, on entend soudain le murmure d’un vieux conte. Une histoire terrifiante et délicieuse glougloute entre les pierres. Le fantôme d’Henri Pourrat l’a récoltée avec précaution et il ne vous reste plus qu’à poursuivre son ombre dans les ruelles bordées de maisons bancales qui vous conduisent jusqu’à la place du marché. Il n’en reste plus grand-chose, à peine deux échoppes. Vous y trouvez quelques légumes d’une fraicheur incomparable et des abricots délicieusement mûrs, cueillis dans le verger de la maraîchère ronde comme ses courges et de sa fille maigre et blanche comme un haricot. Mais surtout, vous découvrez l’étal d’un producteur volubile qui exhume du coffre de sa camionnette rouillée, ses tommes et sa Fourme d’Ambert. C’est du grandiose, du rustique et du vivant. Il se vante devant quelques convaincus de ne vendre ses chefs d’œuvre qu’aux vrais amateurs. Pour les autres, qu’ils bouffent le fromage mort et stérile des grandes surfaces.
On déguste. On savoure les saveurs rudes, puissantes, infinies qui vous peuplent la bouche, émoustillent les papilles. On charge le sac à dos de ces trésors odorants qui seront dévorés respectueusement, à la fraîche, en fin de dîner. On s’étonnera de leur disparition trop rapide.
Et le lendemain, nous prenons un train qui n’existe plus, mais qui traverse le pays sur une voie unique et préservée par des passionnés. Ici, le cinéma français a fait revivre Lucie Aubrac, dynamité les rails pour mieux les restaurer ensuite. Nous remontons le temps au rythme lent des wagons cahotant. On retraverse les villages que nous avons découverts à pied. Cette fois l’Hôtel de la Gare, le bar des voyageurs et l’épicerie accueillent des voyageurs morts depuis longtemps. Des 2CV et des Citroën Type H sillonnent les routes, chargées de victuailles. Dans un tournant, passe à toute allure et poursuivi par des gangsters qui jacassent la gouaille d’Audiard, le camion Willème conduit par Jean Gabin dans Gas-oil.
En face de nous, sur la banquette de ce wagon des années 60, un monsieur en complet veston, bien civil, s’est assis. Il nous a accompagnés de la Chaise Dieu à Ambert, enrubannant chaque montagne d’une nouvelle chronique, glissant adroitement du réel à la fiction à moins que ce ne soit le contraire, commentant les potins du monde et surtout de Paris où, parait-il il y eut quelques jeux, avec la sagesse et l’érudition d’un ermite ironique. Au terminus, à moins que ce ne soit au début du voyage, il s’est levé lentement, nous a salué fort aimablement en distillant une dernière anecdote et s’est dissout dans la lumière éclaboussant le quai.
Nous l’avons retrouvé devant la gare, posé dans un parterre de fleurs un peu négligées qui s’inclinant doucement, lui rendaient un hommage discret et ignoré des touristes.
Nous sommes repartis accompagnés par le sourire ambigu et les émerveillements de Monsieur Vialatte.



Chronique poétique du quotidien 23 — 04/06/2024
Elle me regarde en plein cœur et je ne bronche plus. Je retiens mon souffle. Je ne détourne pas les yeux tant les siens me scrutent intensément. Je la respecte. Je bascule.
Ce regard-là vient de loin et m’entraîne vers l’infini du néant dont elle émerge après s’être si patiemment construite dans le ventre admirable de ma fille devenue mère.
Je reste pantois, bras ballants, j’ose à peine un mouvement devant le miracle de ce corps déjà plein d’esprit. Puis elle m’est confiée. Ma main s’ouvre pour que s’y love son dos. Sa tête repose dans le creux de mon bras. Je m’enracine, arbre frémissant dont les branches ne sont plus qu’accueil. Cela pépie dans ma ramure. Le moindre de mes rameaux tremble, mes feuilles nouvellement écloses bruissent et mon tronc tente de résister à mes bourrasques intérieures. Je me veux plus solide que jamais ! Je me noue et me délie.
Elle se blottit, soupire, déglutit, ferme les yeux, grimace, tortille un peu son corps tout neuf qui apprend déjà à digérer l’amertume.
Voilà qu’à nouveau son regard transperce mon écorce en un éclair de conscience.
Elle me voit en noir et blanc, perçoit mes contrastes et même mes paradoxes. Nous n’allons pas tricher l’un avec l’autre. Un bref sourire passe sur son visage. Je suis hilare. Elle est rassurée. Elle s’endort sous mes murmures émus. Je n’ose plus parler, moi qui aime tant le faire.
Je sens qu’elle m’a adopté. Elle me fait confiance. Désormais, moi aussi.
Alors ma ramée se dresse vers le ciel. Tous mes oiseaux s’envolent, jacassent à n’en plus finir pour annoncer au soleil ébloui que Gaia, ma petite fille, est née. Et que la vie commence.

Chronique poétique du quotidien 22 — 15/04/2024
Le temps n’est-il pas venu de tondre la pelouse. On me l’a dit. Mais je n’ai pas très bien entendu. Ou alors, je n’ai pas écouté, trop occupé à contempler la vie qui grouille, gesticule et caracole sur le moindre brin d’herbe agité par le vent. C’est qu’il y a du beau monde là-dedans. Styllomatophores, testacelles et arachnides. Coléoptères et blattoptères. Anoures et soricidés. Et je ne vous énumèrerai pas toutes ces plantes dicotylédones anémochores ! Contentons-nous d’admirer le pissenlit qui ensoleille le printemps tout en préparant ses akènes à aigrettes qui partiront bientôt en goguette pour semer plus loin des constellations.
Et vous voudriez que je lâche ma tondeuse à gazon et hache menu comme un lâche tous ces animalcules et ces charmantes plantules, sans même éviter les pâquerettes fragiles, tendres et coquettes qui toujours ont séduit les enfants et les poètes. Que nenni !
Il me faudrait peut-être la tondeuse à Gaston qui permet d’éviter de trancher leur blanche collerette et qui, finalement, ne tond rien du tout.
Je me contente de m’asseoir un instant sur la terrasse qui mène au jardin. Je regarde le vent jouer avec les herbes hautes, la lumière et les ombres qui courent sur les feuillages, les hyménoptères un peu engourdis, les oiseaux affairés qui rejoignent leur nid. Ce serait un crime de trancher tant de beauté.
Et puis, il va bientôt pleuvoir.
Et puis c’est encore mouillé.
Et puis va tomber le soir.
Et puis l’heure est passée.
Je reviendrai peut-être demain contempler la vie qui fait son chemin.

Chronique poétique du quotidien 21 — 09/04/2024
J’ai fermé le portillon, mais j’ai emporté la petite clé dorée.
Celle qui ouvre le cœur de mes nouveaux amis. Nous n’avons presque rien dit. Nous nous sommes souri en nous disant merci. Et je suis parti.
Mais je reviendrai. Et si ce n’est pas le cas, car on ne sait pas grand-chose de ce que la vie nous réserve, d’autres trouveront le trésor immatériel qui fut construit : quelques mots semés entre les pavés, des émotions partagées, des regards croisés, des instants de vie, des histoires aussi multiples qu’il y a d’humains…
Tout cela n’est pas grand-chose. Il me parait pourtant essentiel. Peut-être est-ce même une raison de vivre. Les rencontres sont une nourriture qui nous fait avancer plus loin, penser davantage, créer encore.
J’ai fait mes bagages, emporté mes flacons, déjà je prépare de nouvelles valises, mais mon ombre s’accroche aux pavés des venelles de Cahors. Elle glisse sur les façades médiévales et bancales, y accroche son vague à l’âme. Et elle salue les amis qui m’ont ébloui. Elle plane encore un peu parmi eux, éblouie par ce qui s’est vécu. Puis elle glisse sur la rivière.
Je vole donc encore même si j’ai les pieds sur terre. Ce voyage-là n’a pas de fin.
J’ai déposé dans un flacon l’envol d’un nouveau papillon.

Chronique poétique du quotidien 20 — 31/03/2024
Le phylloxéra ne passera pas. Mais la vie circule, s’enracine en brisant la roche calcaire, va chercher l’eau et les saveurs profondes.
J’ai atterri en haut de la colline par surprise. Il n’y avait personne dans le lieu d’accueil. J’ai sonné, appelé les deux numéros de téléphone comme me l’indiquait l’ardoise. Seul un petit chien blanc s’est inquiété de ma présence. Puis il m’a ignoré. Je me suis résigné. J’ai grimpé encore un peu plus haut, sur un chemin de terre, prêt à la promenade en solitaire.
Manu m’a appelé. Viens. Je ne voulais pas répondre, mais puisque c’est toi. Je suis à la bourre. Il faut marcotter, terminer de fixer les vignes. Monte dans la camionnette. Les bourgeons explosent.
Je déboule. Je saute pendant qu’il démarre. Le chien m’accompagne. Nous traversons le vignoble et même si le temps presse, il ne peut s’empêcher de tout m’expliquer : l’interaction radiculaire, les cycles de la lune, la singularité de chaque parcelle. Sa passion l’emporte. Il fait des détours pour me montrer ses expériences.
Regarde là, j’ai planté la vigne dans la forêt. Taillé un peu la cime des arbres. Il faut qu’ils accueillent les nouveaux venus. On verra bien. On plantait ainsi en Italie, avant…
Je bois les paroles en rêvant au raisin à venir.
Et puis il me largue en plein vignoble. Promène-toi. Va voir les filles là-bas, de l’autre côté. Elles fixent les plans. Ça leur fera une pause. Moi, je dois bosser avec Max.
Il empoigne une fameuse binette, forme un trou où il couche une longue branche issue du pied de vigne mère. Tant qu’elle sera alimentée par le pied d’origine, la jeune pousse ne sera pas atteinte par le phylloxéra. Après, on verra. Ici les pieds ont trente ans. C’est mon père qui les a plantés. Quand il y en a un qui meurt, on marcotte. Il se tait, se concentre et courbe la branche avec délicatesse. J’y vois même un geste d’amour. J’ai compris. Je me tire. Max ne dit rien. On déjeunera ensemble à midi.
Je me promène deux heures. Je salue brièvement les deux jeunes femmes qui me sourient, mais qui ont visiblement autre chose à faire que la causette. Je m’éloigne vers le silence. J’entends le chant du coucou. Je respire. Je prends contact avec cet air et cette terre ocrée aux multiples variations de teintes. Çà et là, elle recrache des petits cailloux de calcaire blanc. Dans une parcelle, ce sont franchement des rochers. Un arbre encore effeuillé veille comme un patriarche sur le vignoble. Je longe de jeunes haies récemment plantées qui bordent les rangs des vignes. Des arbres fruitiers se mêlent aussi au vignoble. Entre les pieds de vigne frétillent les pâquerettes et les fleurs sauvages. Manu croit à l’interaction des plantes comme aux liens qui unissent les hommes.
À midi bien passé, je déjeune avec ses potes vignerons. On cause bons mots et bons vins. On ne boira pas d’eau, mais quelques vins frais, du pur jus censé rafraîchir. Vin de soif ? Mon œil ! Il me faudra, comme la vigne, chercher de l’eau.
Manu verse des curiosités. On déguste à l’aveugle. Des jus vivifiants et surprenants par rapport à leur origine : Bourgogne, Languedoc. Des vins nature qui bousculent tous les clichés. Un tannat étonnamment frais surprend des papilles pourtant bien entraînées. Et ça cause, ça s’emballe, avant de partir un peu en vrille et de parler cinéma puis de n’importe quoi.
Je sens la fatigue des jours passés m’envahir.
On s’embrasse. J’emporte du vin. Je m’envole ensuite sur les petites routes qui tournicotent jusqu’à mon refuge provisoire. Je m’offre une sieste. Et je m’endors béatement, convaincu d’avoir emmené un véritable trésor.
C’était au Clos Troteligotte, le Cap Blanc, merci à Emmanuel Rybinski.



Chronique poétique du quotidien 19 — 30/03/2024
Les enfants sont désormais en mission. Ils distribuent des potions plus que magiques qui nous éloignent du tragique. Ils pratiquent l’alchimie poétique. Avec le plus grand sérieux, ils rendent leurs parents heureux, tout étonnés de voir se transformer la réalité. Chacune et chacun a désormais du pot et les collections sont en expansion dans chaque maison.
Madame la Directrice, institutrice-équilibriste, n’est pas peu fière, mais reste calme et modeste. Elle a bien conscience que si tout a commencé aujourd’hui, il faudra recommencer demain, encore et encore, travailler chaque jour pour favoriser l’essor des petits qui grandissent et qu’il faut rendre forts : ils devront prendre soin de ce monde qui les féconde. Leur imagination apportera peut-être de nouvelles solutions.
La vie palpite ici grâce à cette nouvelle et précieuse amie ainsi qu’à tous ces collègues embarqués dans le même bateau.
Je suis monté à bord. C’est un honneur et un grand bonheur. Le vent a soufflé fort, nous avons vu le large, vogué très loin et découvert des îles pleines de trésors.
Je vais bientôt revenir au port, mais j’emporte dans mes bagages le sourire et les émotions de Marie ainsi qu’une petite clé en or qui ouvrira dès que je reviendrai, le portillon de la création.
Merci à toi. Merci à tous.

Chronique poétique du quotidien 18 — 28/03/2024
À Jean Maureille
Le vénérable escogriffe maître en pataphysique est un hibou ébouriffé diurne qui voit la surréalité des choses, vieux sage conscient de sa folie, post-dadaïste capable de monter sur ses grands chevaux, collectionneur compulsif d’objets inutiles, Gaston fier de ses gaffes, poète intact toujours d’attaque. Entre autres choses. On ne fait pas le tour du personnage en quelques mots.
Il m’accueille dans sa maison : portillon rouillé qui grince un bonjour maladroit. J’ai traversé la rue au péril de ma vie. Passent derrière moi les voitures indifférentes. J’échappe à la circulation des idées toutes faites.
Nous entrons dans son pavillon obsolète où l’accumulation des choses est telle qu’il nous faut nous faufiler prudemment, évitant de déranger l’équilibre précaire des livres et des objets. Il me prévient que le royaume bancal appartient à une chatte que je ne verrai jamais. Mais il parait que c’est elle qui a lacéré le fauteuil où il aime se reposer. Il s’y effondre, très satisfait. On cause un peu. On cherche l’équilibre. On ne le trouvera pas.
Il se relève et décide de me faire visiter son grenier qui, bien sûr, est à la cave. Je monte donc en bas. À l’aide d’une torche électrique, il me guide dans ces pièces obscures où son trésor s’accumule depuis des années. Luisances du plastique. Scintillements du verre. Reflets de la porcelaine. Miroitements métalliques. Le faisceau de sa lampe éclaire brièvement le titre des œuvres griffonné sur une bandelette de papier.
Un nain de jardin cruel veille, prêt à trancher et réduire la tête du visiteur indélicat. Je garde la mienne sur les épaules. Jésus se libère de la croix. Il a perdu ses attaches et risque la crise de foi. Une poupée énucléée jette un œil dans le capharnaüm organisé où un cochon en caoutchouc couine. Je reste coi.
À midi, nous mangeons un très honnête foie gras en se désolant de la maltraitance animale.
Qu’on ne s’y trompe pas. Je suis ici en poésie. L’exceptionnelle et l’incongrue. Bien loin des conventions du marché de l’art sur lequel l’anar chie, toujours avec élégance et mélancolie.
L’ami Jean recueille depuis des années les objets abandonnés. Il les ramasse parfois dans la rue, à moitié brisés. Il pille aussi les vide-greniers. Il a l’art d’accoupler un bidule avec un machin, tous deux d’une parfaite banalité, pour créer un émerveillement nouveau, une idée croquignolette, un tremplin à l’imaginaire, une pensée fulgurante. Ce n’est pas rien de faire un tout avec si peu de choses.
Une cuillère devient balançoire un peu louche. Le balai ballerine s’acoquine avec le kitch d’une potiche. Le socle prend le statut de l’œuvre d’art qu’il n’a jamais portée.
Une fois le geste accompli, sans aucune fioriture, Jean laisse retomber la poussière. Elle s’accumule et recouvre tout.
On tousse un peu et on émerge dans le jardin, heureux de reprendre sa respiration. Dans la pelouse désordonnée, une chaise en fer forgé, très coquette, a grimpé sur la table. Elle exhibe ses jambes galbées dans une chorégraphie immobile qu’admirent ses consœurs. On contourne sans vouloir déranger les chaises qui resteront assises. Et on laissera aussi le chariot emprunté à une grande surface digérer les branchages qu’il contient. Le bois pourrira. Le caddie rouillera sur place. Il survivra.
Jean s’interroge : que restera-t-il de nous à part ces quelques traces de ce que nous avons pensé de tous ces petits riens dont tout le monde se fout ? En faire un musée, une fondation sur laquelle d’autres construiront leurs élucubrations ?
Après le déjeuner, Jean m’a proposé d’emporter un objet. Une spirale m’accompagne désormais. Elle n’a pas de fin.
Découvrez ici un catalogue non exhaustif de l’œuvre de Jean : https://maureille.com





Chronique poétique du quotidien 17 — 27/03/2024
Je l’ai croisé au bord de ce chemin que j’emprunte pour exercer ma pratique poétique. Il a écouté ma harangue d’apoéthicaire. Il a souri puis m’a salué en lançant les bras vers le ciel. Malgré son air bourru et impressionnant, j’ai vite compris qu’il était du bois dont sont faits les héros du quotidien. Ceux qui ont vécu avant de venir s’enraciner ici.
Il m’a invité chez lui. Il m’a présenté sa jeune femme et les trois enfants qui ne sont pas de lui, mais qu’il laisse s’accrocher à ses branches. Il accepte le nid. Son tronc craquant, mais solide les aide à grimper plus haut.
C’est un arbre bienveillant et malgré les cicatrices de l’écorce, il est toujours vert.
L’amour qu’il donne et qu’il reçoit l’irrigue. Il déguste l’élixir de jouvence distillé en ce hameau discret, perdu au milieu des collines. Il croyait venir s’y planter seul, au bout d’un long chemin qui lui a fait traverser le monde, vivre d’autres histoires, quitter le confort des futaies et trancher les lianes qui voulaient le retenir. Il espérait être tranquille à défaut d’être heureux. Il s’endormait un peu.
Elle a réveillé la sève. Il a suffi qu’elle passe et qu’elle l’éblouisse de sa très grande grâce. Il a craqué. Il s’est enflammé. Cela n’a pas été si simple. Elle était blessée. Il lui a fallu l’infinie patience et la délicatesse de ses plus fins rameaux. Pour elle, il a fait pousser une nouvelle feuillaison. Elle s’y est apaisée avant qu’éclose la passion.
Tu sens l’ardeur des braises qui couvent dans son foyer.
Nous avons partagé un repas assaisonné d’histoires. Nous avons ri au milieu des cris d’enfants et frissonné en sentant passer le temps.
Puis elle est partie rejoindre la maison qui jouxte la sienne pour y aller coucher ses rejetons. L’arbre et sa compagne savent préserver l’espace propice à l’épanouissement du feuillage personnel.
Lui et moi, nous nous sommes réinstallés à la grande table. Il m’a offert un dernier verre de vin et une tranche de silence. Puis il m’a confié son histoire d’amour. J’ai fait pareil. Nous avons partagé.
Lorsque je suis parti au cœur de la nuit, je me suis senti pousser quelques nouvelles branches.

Chronique poétique du quotidien 16 — 24/03/2024
Je dépose mon frisson de nostalgie sur la peau de la rivière. Elle frémit et l’emporte jusqu’à toi. Je sais que tu le comprendras.
La fête est finie. L’essence d’essentiel a été partagée. Elle nous a enivrés de joie, car nous avons bien senti que nous semions dans un terreau fertile nos graines de poésie. Des fleurs nouvelles écloront demain ou dans quelques années, petits bonheurs passagers qui provoqueront peut-être la vocation de nouveaux jardiniers. Nous n’en saurons rien. Ce n’est pas important. Il faut faire son travail, laisser aller et passer.
Mais je suis chamboulé. Un peu fatigué. Nous avons fait le beau temps. Il est aujourd’hui à la pluie. La tête à l’envers, je fais le gros dos et je vois le ciel basculer dans l’eau. Ce n’est pas rien de s’ouvrir le cœur en laissant pousser les petites racines invisibles qui s’enlacent à celles des amis croisés, complices spontanés de ce qui fut créé. Il n’est plus possible de les arracher.
Elles se dessècheront peut-être si nous oublions de les arroser. Mais j’aimerais que le rhizome perdure, que nous ayons soin de la belle aventure qui nous a rendus un peu plus humains.
Ce sont des mots d’amour que je pose ici. Ceux que nous ne nous dirons pas même s’ils sont là, sur le bout de la langue ou dans la boule au ventre. Que celles et ceux qui les comprennent en prennent de la graine et qu’ils l’emportent plus loin pour la faire pousser demain.

Chronique poétique du quotidien 15 — 20/03/2024
Il est bien joli ce p’tit printemps. Pâquerettes en goguette qui couronnent ma tête de poète. Pouët. Pouët. Je suis ici le roi, une fois ! Belge en vadrouille qui partage ses carabistouilles et ses instants fulgurants de réalité. Mon trésor est vaste. J’accumule. Je mesure ma chance, soupèse ma conscience et je comprends bien ne rien posséder. Je ne suis que de passage, presque aussi sage que mes images. C’est tout dire !
Je suis joyeusement fou de tout, comme enivré de beauté. Les collines me fascinent autant que le Lot qui les dorlote en les enrubannant de brumes matinales. Je m’illumine d’amitiés toutes fraîches, de sourires étonnés, de la fêlure dans les carapaces de méfiance, des petites étincelles qui scintillent dans les prunelles et de ces mots qui se partagent, rebondissent, tissent le lien du langage, apaisent un peu la rage, donnent tant de cœur à l’ouvrage.
Bien entendu, quelques portes restent closes. Il en est qui veulent tellement bien faire les choses qu’il leur est difficile d’approcher les frissons que provoquent mes pas de côté. Je respecte les petits oiseaux prisonniers.
Mais ailleurs, c’est l’envol. Vous entendez ? Les bourgeons klaxonnent et franchement je n’y suis pour rien. Je vous invite simplement à tendre l’oreille pour qu’elle s’émerveille. La sève glougloute. La rivière s’éclaircit la gorge. L’oiseau froufroute dans le soleil. Les pâquerettes caquettent. Voilà que cela bourgeonne dans le cœur des hommes. Il faut dire aussi que les dames ont sorti leur jupette, annonçant la saison des galipettes.
Moi j’ai les bras ouverts, le cœur en bandoulière, je parade un peu et j’attends ma belle qui va voler vers moi à tire d’ailes.
C’est le printemps des poètes. Et je vous dis avec le plus grand sérieux qu’il est possible de vivre des instants heureux.

Chronique poétique du quotidien 14 — 17/03/2024
Je respire. Je me pose. La solitude me prend dans ses bras tandis que je marche dans le petit chemin. Silence.
Ces jours passés, je me suis enivré de ma propre voix qui tentait de prendre au vol tous les mots qui cascadent autour de mes fioles. Il est temps de me taire et de contempler en laissant gambader dans ma tête la sarabande de mes rencontres.
J’aime les plantes et les gens qui poussent sur le bord de nos routes efficaces ou dans les sentiers négligés. Personne ne les regarde. On passe trop pressé, accaparé par l’utile inutile qui nous fait oublier de respirer. J’ai bien évidemment ce grand privilège d’avoir pour boulot à temps plein, la promenade pot éthique et de poser dans des flacons vides mes émotions.
Aussi je ne veux donner de leçon à personne et surtout pas à ceux obligés de travailler pour ne pas perdre une vie si difficile à gagner. Mais je m’interroge sur le bénéfice du sacrifice.
J’aimerais pour chacun suspendre le temps. Se poser là, un instant, devant les herbes folles et les illuminés qui battent la campagne, courent dans les collines, cheveux et pensée en bataille pour poursuivre le vent qui souffle dans leurs oreilles : « Tiens, voilà le printemps ! »
On s’assoirait au bord de la rivière. On remarquerait la violette à peine ouverte et le cri jaune vif d’un pissenlit. On saluerait l’abeille un peu engourdie.
Il y aurait tous ces humains que j’ai rencontrés : les incongrus qui n’ont pas toutes les frites dans le même cornet, mais dont le sourire géant nous éclairerait. L’amie funambule passerait en dansant sur son fil imaginaire pour nous rappeler que l’équilibre ne se crée que dans le mouvement et qu’il est plus noble de se relever après une chute que de rester à jamais immobile. Ses complices clownesques nous offriraient l’élégance tragicomique de ceux qui jouent de leur inaptitude à se glisser dans les tiroirs bien rangés de notre société. Les beaux oiseaux migrateurs venus dans leur habit de lumière pour se poser un instant près de nous avant d’aller voir ailleurs si la vie est meilleure que dans le pays qu’ils ont fui, partageraient nos gourmandises langagières pour fondre nos différences dans la joie mélancolique qui nous unit. Viendraient encore les vieux enfants amoureux du verbe, les bibliothécaires émues embrassant leurs lecteurs et lectrices qu’elles ont vus grandir, des gens d’ici, des gens de là-bas portant à bout de bras et parfois sur le dos, leur baluchon d’émotions. Et comme des arbres enracinés dans la vie, nous communiquerions par le réseau sensible de nos radicelles entremêlées. Nous ne ferions plus que nous émerveiller.
Dans ces vieilles collines qui aujourd’hui m’accueillent, je marche en solitaire pour célébrer toute cette beauté si souvent négligée. Et je dessine un mot nouveau sur le bord du sentier : Poévie.

Chronique poétique du quotidien 13 — 14/03/2024
J’ai donc inventé un nouveau métier : apoéthicaire. Quelle affaire ! Me voilà embarqué dans tout ce que j’ai imaginé. Et je suis de passage dans votre village avec ma collection de jolis flacons. Même les sceptiques s’approchent de mon étal grâce à la vaporisation de mon Fixateur d’Attention.
Mesdames, Messieurs, les autres aussi, tous mes flacons sont vides, mais je vous propose de déguster leur essence de sens ainsi que mes gourmandises langagières. Je les espère à votre goût. Que mes jolis mots guérissent les maux, réveillent les sourires, nous éloignent du pire et suspendent le temps, un instant.
Sur le marché de Catus, au rond-point de Pradines, sur la place de Mercuès, j’ai vu devant ma Remorque Remarquable, défiler petits et grands avec le même regard d’enfant qui soudain se dessille pour pétiller d’émerveillement. Alors en camelot poète, je me suis senti pousser des ailes poursuivant avec une énergie nouvelle mon discours volubile. Écoutant aussi avec émotion toutes ces histoires humaines qui viennent tourner autour de mes pots.
Voici la veuve anglaise qui a dû quitter la maison de pierres qu’elle avait restaurée jadis avec son chéri ; l’ébouriffé ours des montagnes qui se méfie de ses contemporains ; le tailleur de pierre philosophe qui a fait bien du chemin en prenant souvent les sentiers de traverse ; le joli couple d’amoureux dont c’est aujourd’hui l’anniversaire de mariage, qui a quitté sa colline pour venir me voir et qui s’en va en rougissant, main dans la main, après que je lui ai offert une dose d’amour ; ce monsieur très respectueux qui m’apporte dans un petit carton huit très jolis flacons afin que je poursuive ma pratique poétique ; cette procession d’enfants accrochés à une corde qu’entraîne leur instituteur rêvant de posséder mon Élixir d’Ubiquité et cette bande de saugrenus, trisomiques romantiques, qui entre dans le jeu très sérieux de ma petite boutique…
Je ne vends rien. Je reçois tout. Et je pense à Prévert qui grognonne si justement dans le nuage de tabac qu’il doit fumer là-bas, que la poésie est l’autre mot pour dire la vie.

Chronique poétique du quotidien 12 — 11/03/2024
Virgules torturées dans le champ caillouteux. On pourrait croire la vie entre parenthèses. Les pieds de vigne se tordent, grincent et murmurent en promettant des plaisirs futurs.
Faut-il donc toujours souffrir pour faire naître la beauté ? N’y a-t-il pas un peu de perversion humaine dans cette aptitude à chercher la douleur pour que jaillisse un jour la jouissance ?
Patience. Les radicelles s’insinuent dans la roche calcaire. Elles fouillent lentement dans l’histoire de cette terre où, comme ailleurs, tout retourne à la poussière pour former un terreau singulier. Le mouvement est imperceptible. L’eau ruisselle. L’humus se décompose. Les sédiments s’interpénètrent. L’organique épouse le minéral.
Le travail de l’homme et les cycles lunaires, la vigne silencieuse capte tout.
Elle est du bois dont on fait les héros dans un champ de ripaille que l’on croit immobile. On se trompe. Il s’agit d’un autre rapport au temps qui échappe à notre perception de promeneur passager dans cette vie qui coule, s’étire, se retient. Elle va jaillir bientôt en bourgeons éclatants, lançant ses vrilles juvéniles vers le ciel et préparant l’épanouissement du Malbec que l’homme transformera en panacée pour se croire un instant égal aux dieux qu’il a inventés.

Chronique poétique du quotidien 11 — 08/03/2024
Prenant de la bouteille et tournant toujours autour du pot grâce à ma pratique poétique, je me retrouve ici et là. Et aujourd’hui dans ces villages où des humains partagent les joies du langage et des émotions. Je sens qu’en ce printemps germent les graines d’amitié.
Et puis voici que viennent les enfants. Celui-là est un peu comme les autres bien qu’ils soient tous différents. Mais il a ce regard qui vogue vers le vague avant de revenir vers vous s’il juge pouvoir vous faire plus ou moins confiance. Ce n’est pas gagné. Il faut suspendre le temps. Il s’effarouche vite pour fuir dans ses sous-bois. Il reste aux abois.
Après avoir caressé le papier et osé y poser un peu d’imaginaire, voilà qu’il se met au travail méticuleusement. Il est parti ailleurs à moins qu’il ne soit particulièrement ancré dans le réel. Ne l’interrompez pas. C’est un petit dieu incarné qui crée son univers à la pointe de ses crayons de couleur. Il fait couler le sang, frôle la chair, pétrit la boue, laisse aller sa peine sous des rayons de soleil et fait jaillir des larmes de joie, confiant une histoire secrète qui s’infiltre dans la fibre du papier. Il finit par la graver tant il y met de la force.
Une étiquette est créée. Il me l’apporte fièrement afin que je la colle sur le flacon qu’il a soigneusement sélectionné. Il me prie d’être précis. On ne rigole pas. Il faut cacher une trace qui le dérange sur le verre immaculé. Nous jouons le plus sérieusement du monde.
Il a imaginé une potion pour que ses parents ne meurent pas.
Il possède cette conscience du tragique de l’existence qui fait de nous des êtres humains.

Chronique poétique du quotidien 10 — 07/03/2024
Madame la République française range ses enfants derrière des bancs, bien alignés par ordre de taille, les pieds plantés dans un terreau ancien mêlé aux cendres de leurs ancêtres, pour qu’ils s’y enracinent.
Un maître ou une maîtresse les arrosent tous les jours grâce à un vaporisateur breveté diffusant le calcul, la grammaire et la citoyenneté afin qu’ils poussent bien droit.
Certains, pourtant, grandissent de travers ou un peu en décalage. Ils sont alors pourvus d'un tuteur particulier, venu d’ailleurs et qui en a connu bien d’autres. Généralement des vertes et des pas mures. On ne la lui fait pas. Mais ayant aussi souffert d’un léger décalage et n’étant pas enraciné, il développe une forme d’empathie qui favorise l’épanouissement du jeune plant. Rapidement celui-ci bourgeonne, surtout à l’approche de l’adolescence.
Lorsque la pépinière devient trop chaude, le maître ouvre une fenêtre par où s’envolent immédiatement les idées les plus folles. Elles reviennent par la porte, récoltées par l’intervenant extérieur, un genre de jardinier subventionné par l’une ou l’autre institution. Il vient marcher sur les plates-bandes. On ne connait guère sa pratique. On se méfie d’abord.
Mais il sème peu à peu des graines de poésie, fait jaillir quelques sourires en prétendant que le jeu en vaut la chandelle et s’il est assez adroit, il fait fleurir la complicité.
Alors le calcul, la grammaire et la citoyenneté s’épanouissent d’une nouvelle façon. Ce qui fut semé en amont, germe tout à coup et grimpe jusqu’au plafond.

Chronique poétique du quotidien 9 — 05/03/2024
À mes pieds, coule la belle rivière. Elle s’habille de brume, joue la coquette, ne se dévoile pas encore. Elle ondoie et me jauge. Je suis un nouvel étranger porté ici par le courant de la vie.
Un touriste, peut-être ? Le genre de type qui pollue visuellement ses berges en exhibant son bermuda multicolore. Ce n’est pourtant pas la saison. Le vacancier n’est pas encore mûr.
Mais alors, que vient faire cet apoéthicaire belge qui a l’audace et l’inconscience de conduire sa remorque remarquable dans les petites routes serpentant entre les collines ? Viendrait-il fourguer ses potions, le trublion ?
Il assure pourtant ne rien vendre mais proposer l’essentiel.
À d’autres ! Elle en a vu des hurluberlus, cherchant les chèvres, voulant faire tout un fromage puis grelottant l’hiver dans des masures à peine restaurées et fuyant bien vite vers la ville qu’ils n’auraient jamais dû quitter.
Depuis, son eau a coulé sous les ponts. La rivière a retrouvé le calme, la solitude et sa puissance immuable comme celle du temps qui passe.
Elle conclut : le camelot-poète est un oiseau de passage venu se poser un instant. Elle en a connu des volatiles porteurs d’ailleurs. Elle frissonne. Dans un nouveau remous, elle rêve d’envol au milieu de la brume.

Chronique poétique du quotidien 8 — 03/03/2024
Je me suis arrêté à Noan-le-Fuzelier en Sologne, entre deux étangs dont je ne discernais plus les limites tant la pluie les abolissait. Ce n’était pas si loin mais j’étais déjà au centre de nulle part. Et certainement ailleurs.
L’endroit idéal pour faire étape épatante, manger l’œuf en cocotte où surnageaient voluptueusement trois gastéropodes supportant l’ail et le persil, déguster le verre gouleyant de Saint Amour et tailler la bavette bien saignante.
L’hôtel était vide, hors saison, hors d’âge. J’y ai posé mes bagages et mes pensées confuses. En fermant les yeux, je voyais encore défiler la route. Quand je les ai ouverts, j’étais dans le hall. Je stationnais. La patronne me confiait la clé et m’indiquait le couloir obscur qui conduisait à ma chambre.
A cet instant la gazelle passe-muraille a surgi, sans doute pour m’aider à porter mon petit sac de voyage.
- Ne vous inquiétez pas, m’a murmuré ce cher Marcel Aymé, c’est un souvenir d’Afrique et elle est très serviable.
Quand même, c’est bien chouette, la France !

Chronique poétique du quotidien 7 — 25/02/2024
Les enfants sont pathogènes, surtout en cette saison. Méfions-nous des plus morveux. Car dès que vous en multipliez le nombre et les regroupez en classes d’écoliers, ils se transforment en un véritable bouillon de culture. Vous risquez le rhume, la sinusite, le virus en mutation, l’exotique infection, voire la redoutable pneumonie si vous compliquez les choses.
N’écoutant pourtant que mon courage, je persiste et tourne avec mes potions, flacons et autres fioles dans les écoles. En tant que Président Directeur Généreux de la Grande Droguerie Poétique, je suis devenu référent culturel dans un programme destiné à donner accès à la culture et à la création aux élèves de la Fédération Wallonie Bruxelles (ministère de la Culture et de l’Enseignement en Belgique). J’en suis heureux, parfois fatigué et fier. Et je résiste donc aux microbes et à tout ce qui nous voudrait tristes, en pratiquant mon art d’apoéthicaire qui consiste à soigner tous les maux par les mots.
Les aventures se multiplient : je découvre de charmantes petites écoles de campagne ou de grandes structures séculaires, des écoles où les enfants sortent par une fenêtre de la classe pour rejoindre la récréation ou des bâtiments plus carcéraux, des enseignants passionnés dans la majorité des cas, parfois submergés par les tâches administratives, harassés par le fonctionnement des structures ou fatigués par tous les problèmes sociaux que les enfants subissent. Mais ceux qui tiennent le coup sont toujours amoureux et conscients de l’importance d’un métier qui devrait être revalorisé d’urgence.
Car les classes rassemblent tout ce que notre société en crise provoque : des élèves angoissés, mais capables de joie et d’émerveillement, des enfants en manque d’affectif tentant de se débrouiller dans leur famille décomposée, des mômes sans culture ou décervelés par la lénifiante pensée unique du grand commerce et l’imaginaire prémâché des écrans. Mais ils sont pourtant tous avides de mots inconnus, de vocabulaire luxuriant, de poésie vivifiante à la syntaxe décalée pour peu que le ludique triomphe avec le plus grand sérieux. Et ne vous y trompez pas : ils pensent ! Ils ne demandent que cela ! Il suffit de leur révéler quelques outils et les mots pour dire, et tout émerge.
Ils sont capables de créer leur propre vie, un monde qui bouge, des solutions nouvelles et des utopies rafraîchissantes par la puissance de leur imaginaire, cet outil dont ils auront le plus grand besoin.
Nous poursuivons donc patiemment notre révolution douce.

Chronique poétique du quotidien 6 — 18/02/2024
Il me faut écrire bref, car le temps passe. Vous avez remarqué ?
Et pourtant j’aimerais vous raconter toutes ces histoires improbables que je vis et glane ici et là, lors des rencontres que ma pratique poétique et simplement la vie, entraînent.
Il me faudrait être plus régulier, multiplier les chroniques puisque plus que jamais et malgré l’effondrement de la chaîne du livre et de bien d’autres choses, je crois à l’importance des mots qui nous connectent.
Mais bien souvent, face à la violence du monde, je m’interroge, bras ballants, époustouflé. Le quotidien aussi peut être soudain contaminé par l’inacceptable.
Lundi passé, j’allais heureux et à deux doigts de l’insouciance, chercher ma petite fille à la sortie de son école, dans cette ville que j’ai quittée.
Je fus soudain le témoin du tabassage extrêmement violent d’un petit fumeur de crack qui avait tenté le vol des portables de quelques grands adolescents du quartier. Ils l’ont pris la main dans leurs sacs. Et leur haine a explosé. Poursuivi comme un animal, roué de coups, hurlant des appels au secours, ensanglanté, il est venu s’effondrer au milieu d’un rang de très jeunes écoliers qui descendaient la rue pour rejoindre l’école où j’allais chercher ma petite fille. Aveuglés par leur rage, les bourreaux ne voyaient plus rien, bousculaient les enfants terrifiés que tentaient de protéger deux institutrices paniquées, tandis que comme une bête traquée, le lamentable fumeur de crack rampait sur les pavés.
J’ai osé parler à celui qui me paraissait le plus violent et dont les poings étaient maculés du sang de sa victime, gisant désormais immobile sur le trottoir. Il s’est calmé, bafouillant sa colère. Les mots rugissaient encore, mais ils ont remplacé les coups. Puis le bruit de la sirène d’une voiture de police l’a fait déguerpir ainsi que la meute de ses compagnons. Les enfants abasourdis ont trotté derrière leurs institutrices. Il n’est resté sur le trottoir que ce jeune homme sale et blessé, à moitié inconscient. Une jeune femme l’a doucement placé en position latérale. Il s’est recroquevillé, fœtus abandonné dans le caniveau.
Mes mots se bousculaient. Mon cœur battait fort. J’étais au bout du langage.
Je me suis remis en marche après avoir fait une brève déposition à un flic blasé.
J’ai été chercher ma petite fille, retrouvé sa fraîcheur, son sourire, sa confiance. Je me suis senti vieux.
Et je voudrais pourtant toujours changer le monde.
Chronique poétique du quotidien 5 — 01/08/2023
Je pratique le voyage immobile. Surtout cet été où il me parait obscène d’aller voir ailleurs ce qui y flambe si bien et d’exiger ensuite le remboursement de ses vacances annulées pour cause de catastrophe climatique. Je ne juge personne. Je m’interroge sur ces transhumances si nécessaires pour fuir, une ou deux fois par an, l’aliénation au travail. Il faudra bien un jour stopper les engrenages de la machine inconsciente. La vie y a déjà semé ses grains de sable.
Moi, je m’envole sans avion au bout de mon jardin. Cela n’a rien d’exceptionnel. C’est presque une habitude. Mes chiens me promènent. Ils ont l’art de m’entraîner par de nouveaux chemins très proches de ma maison, mais que, pourtant, je ne voyais pas. Je n’ai pas leur flair. Il suffit de si peu pour que s’ouvre une nouvelle piste : l’envol d’un insecte, un bruissement dans les feuillages, l’odeur de pétrichor ou peut-être celle d’un hypothétique gibier que mon odorat atrophié ne perçoit pas.
L’aventure est au coin d’une rue de mon village. Je prends la pente douce, explore un sentier de traverse, défriche un layon oublié dans le petit bois d’à côté. Nul besoin d’aller bien loin puisque l’infini est à portée de la main, dans la spirale de la coquille d’un escargot que je prends soin de préserver.
Je puis naviguer dans le ruisseau qui se gonfle d’importance grâce à la constance de la pluie. J’y jette mes plus sombres pensées qui s’éloignent en godillant pour rejoindre l’océan de mon imagination.
Et puis, je reviens dans ma caverne pour m’écrire des cartes postales. Je suis bien obligé d’abord de les créer moi-même, car le touriste amateur de souvenirs et aimant annoncer à ses amis ou sa belle-maman qu’il ne les oublie pas, mais s’amuse bien quand même, se fait rare dans mon Barbant Wallon. Il néglige le joli patrimoine pour s’en aller planter sa tente ailleurs fuyant la gamme très étendue de pluies : averse et déluge, bruine et crachin, ondée, giboulée et drache régionale. Y’a pas photo. Nul photographe n’a osé se mouiller.
Dans mon courrier intérieur, je me souhaite d’aller bien, de me détendre et de me reposer avant de reprendre la route et de porter ailleurs les mots qui auront décanté pendant cet été si particulier où ma fille, mon trésor, a été opérée de la colonne vertébrale afin de lui redresser l’avenir. Le réel est là, cerné de mes mots doux, mais plein d’angoisse et de tout l’amour ressenti, dans l’impuissance relative qui nous est imposée lorsque ceux que l’on aime sans limites traversent une épreuve qui nous laisse en attente, les bras ballants, sur le bord du chemin. On reste. On patiente. On accueille leur douleur et l’on prépare maladroitement une route nouvelle pour qu’elle soit très douce sous leur pas de convalescent.
Ma maison est un navire bienveillant. Il tangue un peu sous la pluie de ce mois d'été qui délave le jardin et transforme les chiens en mammifères marins. Je reste capitaine, attendant les prochains voyages au long cours. Mais pour l’instant, j’ai jeté l’ancre dans cette réalité. Le cœur est parfois à marée basse, mais l’amour monte. Et je préserve mon trésor.

Raconter des histoires — 18/05/2023
Chronique publiée dans le journal jovial, crédule, saugrenu mais outrecuidant : "el batia moûrt soû" n°87 mai-septembre 2023
Certaines ont plutôt bien réussi et franchement, ce ne sont pas les meilleures. Il faut se faire une raison : plus c’est gros et plus ça passe. Et puis l’humain est tellement terrifié à l’idée de disparaître qu’il imagine et parvient à croire n’importe quelle fiction lui promettant l’éternité. Tenez : une des plus absurdes reste quand même celle de ce type tout nu qui vivait dans la béatitude paradisiaque et qui laisse à ce qui n’existe pas, lui retirer une côte pour en faire une meuf, une chouette, avec tout ce qu’il faut. Vous connaissez la suite, plus invraisemblable encore, avec ange lubrique, vierge innocente et charpentier cocu. Cette histoire-là finit sur une croix pour mieux recommencer. Deux mille ans de scénario débile. Et ce n’est pas fini. On poursuit ou on revient même à l’improbable et au farfelu après avoir trucidé le sceptique, brûlé l’hérétique et la sorcière, massacré le sauvage qui avait l’audace d’avoir l’imagination différente. Aujourd’hui, tandis que quelques-uns se disent qu’on va droit dans le mur, qu’il s’agirait d’être un peu plus modeste en ne se croyant pas le nombril du monde pour avoir créé un dieu à notre image et qu’il faudrait enfin avoir conscience que nous ne sommes qu’une sorte de parasite dans la grande histoire de la vie, la plupart et surtout ceux qui inventent chaque jour le fonctionnement de nos sociétés en déliquescence en faisant perdurer leurs réflexes de prédateurs, imaginent de nouvelles fictions sensées résoudre tous les problèmes, les angoisses et nous faire oublier la fin de toute chose. S’ils ne proposent pas un dieu, ils ont l’art de faire glisser le désir vers des paradis illusoires préservés par le pouvoir d’achat, adorant l’argent qui n’est qu’un autre code fictionnel pour consommer en consumant.
Tenez, les bagnoles par exemple. Pour la plupart d’entre nous, il est bien difficile, voire impossible à moins d’être totalement masochiste en faisant du vélo ou en prenant les transports si communs, de se passer de cette carapace d’acier qui nous accueille à la fois comme un utérus consolateur et nous rend surpuissants lorsque nous nous lâchons parfois, poussant le compteur sur l’autoroute des vacances en provoquant çà et là, l’accident spectaculaire qui limite d’un coup le nombre de spécimens de notre espèce. Et bien, vous pouvez écraser tranquille. Nous allons poursuivre encore le temps qui nous reste, cette forme de sélection naturelle en épuisant toujours davantage les ressources de la Terre. Plus de pétrole ? Qu’à cela ne tienne. Inventons la fiction de la voiture électrique en la faisant croire écologique. On déplace le problème en exploitant les mines de lithium nécessaire à la fabrication des batteries et l’on pollue ailleurs où les écolos ne sont pas là pour pinailler. Cela tombe bien, le plus grand gisement de lépidolithe connu se trouve au Zimbabwe. C’est une vieille tradition d’exploiter là-bas ce que ces feignants dédaignent et ce n’est pas eux qui rouleront en Tesla.
Et à propos des écolos ou de ceux qui soi-disant les représentent, eux aussi racontent des histoires à dormir debout. « Nucléaire, non merci ! » qu’ils disaient. Une fois embarqués dans les fictions gouvernementales qui nous sont diffusées par les médias qui s’y connaissent en narrations aliénantes, ils ont retourné leur chemise à fleurs, baissé le pantalon de velours et se sont félicités avec le monde marchand de prolonger l’existence des centrales nucléaires. Et tout passe. On gobe. On avale. On s’indigne parfois un peu. On ne passe à aucun acte et on intègre le feuilleton en s’inquiétant vaguement du prochain épisode. Bref, on se raconte des histoires.
Comme je viens de le faire, mon ami. Tu as peut-être souri, tu as trouvé que je caricature, que j’exagère. Tu as passé simplement et je l’espère, un peu de bon temps.
Mais je ne cherche rien d’autre en écrivant ces mots que de vivre encore un peu en partageant sans en être dupe, nos absurdes récits. Toutes ces fictions contiennent aussi ce qui nous réunit. Et elles sont gouleyantes et exquises quand elles s’épanouissent dans les aventures littéraires dont il faut d’urgence abreuver tous ceux qui s’en méfient pour en avoir été dégoûtés par un enseignement stérile ou la prétention des cercles d’initiés. Dégustons surtout l’histoire si singulière de chacun, accoudés au comptoir de la vie, couchés dans le lit des confidences. À force de les imaginer, car toujours nous imaginons le réel, elles changent un peu le monde en nous le rendant plus supportable.
Prenons-les donc pour ce qu’elles sont, mais que jamais elles ne nous imposent de vivre ou de penser d’une seule façon. Et choisissons celles qui nous permettent de rêver debout.
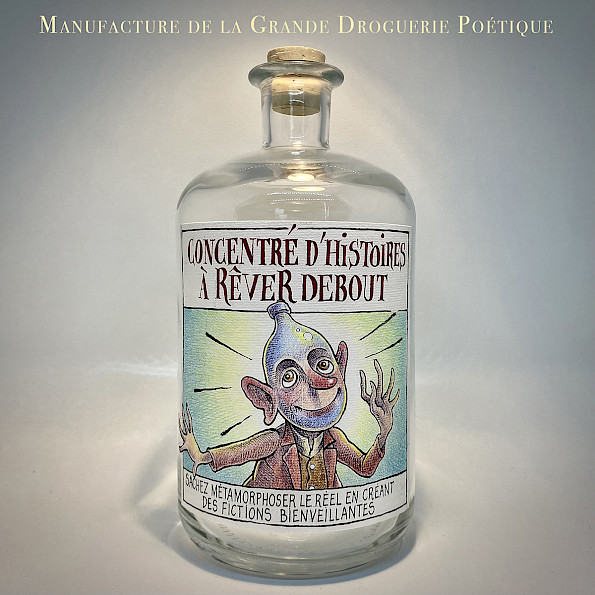
Chronique poétique du quotidien 4 — 07/02/2023
Nous aimerions plus de lumière, sortir enfin de cet hiver et des pensées inconfortables qui nous font frissonner l’âme. Nous écoutons depuis trop longtemps le craquement des os et les idées morbides. Mais il faut patienter, laisser à la saison le temps de passer. Nous contemplons l’arbre démembré, impitoyablement taillé. Et nous voulons croire en ce prochain printemps qui le ressuscitera peut-être.
Nous revoyons nos projets. Nous ajustons les désirs. Nous voulons créer encore en nous éloignant du pire. La vie est à portée de la main pour peu que l’on ose se remettre en chemin. Mais nous hésitons encore. Nous rongeons notre frein.
Demain ou dans quelques jours, nous redeviendrons mobiles et volubiles. Nous sortirons de l’hibernation et de notre caverne platonique. Il y aura du soleil et de l’air et des chants. Nous redécouvrirons enfin que tout est toujours possible pour celles et ceux qui entrent dans la danse du vivant.

Chronique poétique du quotidien 3 — 01/01/2023
Devant ce que l’on espère être une page blanche, on fait le bilan et on énumère ses projets comme si tout allait commencer aujourd’hui. On est plein de résolutions. C’est un peu comme ce premier jour d’école, il y a bien longtemps, lorsqu’on était petit. Les cahiers étaient neufs, propres, immaculés. Ils vous proposaient des marges vides où tout semblait possible. On caressait le papier lisse en rêvant à de prochains enchantements. On y croyait en redoutant quand même l’effort et la sévérité du maître. Et puis, il y avait les copains et les trésors de nos poches. L’aventure nous attendait dans le coin le plus reculé de la cour de récréation.
Aujourd’hui, nous retrouvons notre candeur à l’aube de l’année nouvelle. On fait tout pour y croire en rassemblant les amis et en faisant la fête. Il y a des trésors dans les poches de nos costumes et dans celles des jolies robes. On boit. On rit. On danse. Au petit matin, on s’endort un peu lourdement, des paillettes dans la tête.
Réveillé vers midi, on réalise soudain qu’il nous faut poursuivre et non recommencer. On s’extirpe des draps froissés et de la brume qui engourdit notre esprit. On grignote quelque chose. On boit de l’eau.
On consulte notre agenda numérique dont les pages ne sont pas blanches. Bien des choses sont déjà prévues. La machine nous prouve encore davantage que tout continue. Il va falloir se retrousser les manches et revoir sa copie pour arriver enfin à réenchanter le monde. Il est temps de retrouver les aventures des coins sauvages et préservés de nos cours de récréation.
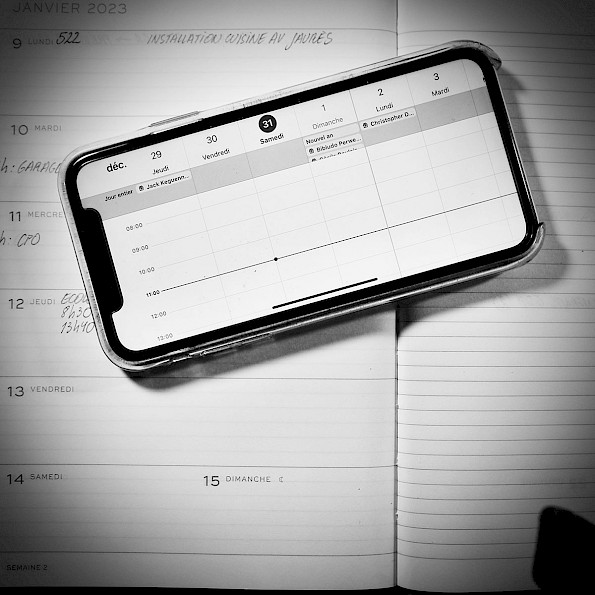
Chronique poétique du quotidien 2 — 15/12/2022
N’allez pas croire que c’est facile même si j’ai beaucoup de pots. L’aventure est bien thérapoétique et je me soigne à coups de bons mots. Encore un pour la route que je reprendrai après cet hiver où l’inadmissible et l’absurdité recouvrent le monde. En avez-vous, comme moi, l’overdose ? Rêvez-vous de vaporiser d’urgence un concentré d’éthique footbalistique, des doses infinies d’empathie, un extrait de Révolution Douce, un exhausteur pour la conscience de n’être jamais assez humain et de la modestie de se savoir n’être rien mais faire partie d’un tout ?
Pas d’autre choix que de créer ce que l’on peut, c’est-à-dire peu de choses : quelques étiquettes sur des bouteilles vides qui deviennent mes flacons d’espoir.
Je déguste alors une liqueur d’amertume aux saveurs mélancoliques d’utopies anciennes qu’édulcorent souvent un sourire bienveillant ou une complicité langagière. Je m’épanouis un bel instant dans une relation textuelle. Et puis, je poursuis ce chemin dont je perçois la fin en espérant encore quelques détours, des risques d’impasses, des sentiers ensauvagés ou des routes en travaux. Qu’importe l’incident, mais qu’il allonge le trajet !
Mais en ce jour, l’immobilité de l’hiver nous impose la caverne et le repli. Il ne faut surtout pas se laisser hypnotiser par les écrans chatoyants qui ont envahi nos refuges et dégueulent leur vulgarité. Veuillez faire taire les propagandes. Muselez la bêtise. Préférez la couette, un poème, des instants de joie voire un peu d’amour. Même si elle est meilleure à deux, sachez déguster votre solitude. Promenez vos chiens. Contemplez le givre iridescent sur une branche lorsque la lumière point. Tracez quelques mots sur une feuille. Faites un dessin. Veuillez vous faire du bien.

Chronique poétique du quotidien 1 — 07/12/2022
On avance. C’est inéluctable. Et autour de nous, des amis se font rares ou disparaissent. Les projets anciens sont réalisés et nos traces s’estompent. Nos voyages sont devenus des souvenirs.
Vient le mois de novembre. On se recroqueville un peu frileusement. Ce n’est pas désagréable. À l’abri dans sa caverne, on concocte de nouvelles recettes. On rêve au printemps et à des élans nouveaux. On le sait : notre activité survivra par le mouvement que l’on créera. Pendant cet hiver, le Laboratoire Mobile de la Grande Droguerie Poétique se construit. Ce ne sera plus notre camionnette, mais une caravane aménagée qui nous permettra de présenter nos produits imaginaires au public. La tournée se prépare. Au printemps, nous prendrons la route pour diffuser nos doses de joie et de résilience. Et le chemin, là-bas, est déjà lumineux.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal (fin ?) 63 — 02/07/2022
Point final ou point de suspension ? Je suis revenu en avion, perdu dans la foule, accroché à mes valises en guise de bouée, dans la marée humaine du mois de juillet. J’ai nagé en sens contraire pour retourner chez moi.
Salut Montréal ! À bientôt, mes amis. J’ai emporté avec moi des parfums, des sons et tant de couleurs, des mélanges d’histoires et des morceaux de poèmes, des destins qui s’entrelacent à la croisée des chemins, des projets à construire pour oser le bonheur.
Je clôture ici l’étrange exercice que je me suis donné dans la grande liberté qui me fut octroyée lors de cette résidence. Je n’ai pas contraint l’écriture, elle m’a permis de vivre intensément et de partager ma modeste aventure avec celles et ceux qui ont eu la curiosité de m’accompagner. Allons-nous bientôt nous retrouver dans la beauté d’un livre fraîchement imprimé ?
Restons en suspension. Ce sera mon point final.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 62 — 30/06/2022
Le temps est venu de replier son bagage, de fermer le carnet pour le rouvrir ailleurs. C’est un retour à la case d’un nouveau départ. Aujourd’hui, je prends l’avion même si le jeu n’est pas terminé. Comme j’ai plus d’un tour dans mon sac, je vais lancer les dés du hasard pour qu’ils mènent la prochaine partie. Il faut savoir tenter sa chance. Tout va bien. Les jeux sont toujours à faire.
Ce matin des nuages bonhommes, rondouillards et rosés, couvrent le Mont-Royal. Avec grand calme, ils accompagnent cette tempête un peu confuse qui emplit mon âme. L’air est humide comme mes yeux.
Je replie les chemises, enferme dans mes valises le rire de mes amis. Il en est assourdi. Je vais emporter quelques nouveaux livres, des parfums, des images, des gestes inaccomplis, des élans retenus, des phrases laissées en friche.
Je devrai revenir ici. Mais que sais-je de mes prochaines années ? Aurai-je assez de temps pour encore tout tenter ?
Je ferme mon stylo, range l’ordinateur, compagnon improbable qui contient les trésors que j’ai accumulés. Il faut dire au revoir à ce curieux bureau où j’ai passé des heures à m’enivrer de mots pour cerner la réalité de tout ce que j’ai rêvé. À moins que ce ne soit le contraire.
Je caresse la table, tire les rideaux sur le beau paysage que j’ai tant contemplé du haut de mon nichoir d’oiseau migrateur.
Ce voyage ne m’a pas rendu plus sage, je n’ai guère plus de raison, je reviens demain au village, le cœur gonflé par la passion.

Chronique poétique d'un voyage dans... la baie de Saguenay 61 — 29/06/2022
Bienvenue à bord, Mesdames and Gentlemen. Je suis le capitaine de la Marjolaine. Et il en faut du courage avec cet équipage, mais ne vous inquiétez pas, nul naufrage n’est programmé lors de notre croisière.
Nous allons vous faire traverser en une seule journée tout l’ennui des vacances, naviguant joyeusement sur le fleuve, imposant notre gaieté au fjord du Sagenay, vous infligeant dans nos haut-parleurs les bons mots de notre guide et les rengaines de nos chanteurs. C’est beau. C’est populaire. Le décor est sublime. Le temps est idéal. Vous cramerez sous le soleil. Nous vous ouvrirons les yeux et les oreilles. Il est permis et même recommandé de s’egoportraitiser. Vous pouvez utiliser les toilettes, mais commencez par écluser les bières du bar.
À midi, nous vous libérerons dans le petit village charmant de Sainte-Rose-du-Nord qui compte, c’est étonnant, deux restaurants. Les premiers débarqués auront les meilleures places sur les terrasses.
Vous serez un plus lourd lorsque vous remonterez à bord. Nos calembours aussi. Vous serez fatigués. C’est dur l’aventure !
Vous voudrez peut-être faire taire le guide, mais il est admirable, intarissable. Il enchaine les petites ou grandes histoires. Inutile d’y croire ou d’en attendre la fin, il n’y arrive pas toujours. Quant à ses anecdotes, ses dates et ses chiffres, on s’en moque. Veuillez cependant conserver votre calme lorsqu’arrivera cet instant fatal où vous et moi nous aurons envie de le pousser par-dessus le bastingage. Ce serait dommage. Il n’est pas si facile de trouver un tel moulin à paroles capable de mêler toute l’histoire des Amérindiens avec celle d’un fromage du coin. Si vous n’avez pas suivi, tant pis.
Vous reviendrez au port, un peu soulagés. Une sorte d’épreuve sera terminée. Vous aurez beaucoup ri avec vos amis et osé même des jeux de société.
Je vous ai avertis et je le redis : nous réussirons aujourd’hui la traversée de l’ennui. Veuillez admirer mes galons. Les femmes et les enfants d’abord. Que la bonne humeur règne à bord et que la croisière s’amuse.
(Avec la participation exceptionnelle de Madame Anne Villeneuve, dans le rôle de la passagère assise à côté du Commandant).

Chronique poétique d'un voyage à... Chicoutimi 60 — 28/06/2022
Leurs crochets carnivores agrippèrent les grumes après avoir abattu les arbres victimes de la faim qui dévoraient les hommes. Ce pays confisqué abolissait les limites. Il leur fallait bouleverser les collines, éventrer les clairières, exploser le rocher, détourner les rivières, faire tourner les turbines, imposer l’industrie. Ils étaient enivrés par la vapeur de leurs machines qui exigeaient toujours plus le sacrifice des corps organisé avec bonne conscience par les ingénieux patrons. L’ouvrier perdait là, un doigt, un bras, une jambe. On appelait les « sans-pouces » ceux qui travaillaient à la scie circulaire. Et l’industrie florissante en voulait plus encore en proclamant l’urgence du progrès. On sacrifiait les poumons des enfants, on honorait brièvement le père qui avait disparu dans la rage du courant s’engouffrant dans les boyaux monstrueux alimentant les moulins.
Tout cela pour fabriquer cette pulpe nécessaire au papier. On imprimait alors tout ce qu’il fallait connaître, les journaux qui étaient des fenêtres sur le monde, les livres des comptables, les titres de propriété, un peu de littérature et parfois de nouvelles idées qu’il fallait diffuser.
En attendant, le travail dévorait et il n’était pas question de se syndiquer ailleurs que chez monsieur le curé, un grand expert de la vie sacrifiée.
D’ailleurs le fronton du moulin de l’incroyable usine, ne fut-il pas dessiné comme celui d’une église ? On croyait encore en une récompense céleste qui aidait à supporter le bruit des machines dans cette vallée de larmes. Et on était prêt à tout pour gagner plus d’argent.
Ici furent broyés des forêts séculaires, la vie des ouvriers, des espoirs, des chimères. On en fit du papier.

Chronique poétique d'un voyage à... l'Anse Saint Jean 59 — 27/06/2022
Deux ou trois jours, quelques heures à peine pour appréhender le roc, la forêt, une terre sans limite où serpente un fleuve qui faisant l’amour à l’océan en est devenu salé, conservant les saveurs de l’origine. Un tambour très ancien bat ici sourdement, résonne dans ma poitrine gonflée d’émerveillement.
Suis-je au début ou à la fin du monde ? Tout ici commence pour certains qui ont cherché leur chemin. D’autres pourraient choisir avec sagesse d’en accepter la fin.
Je passe. Ma présence ne dure que quelques secondes. Comme pour mieux révéler toute mon insignifiance, la nature déploie ses contrastes vertigineux. Pics et vallées, rochers éboulés où s’agrippe la calme résilience d’arbres décharnés. L’espace est infini, bleuit à l’horizon, l’univers est toujours en expansion.
Je ne peux que marcher et bien humblement. Je me liquéfie hier sous un soleil de plomb et ce matin la pluie déborde des gouttières à gros bouillons. Le projet d’une simple promenade est balayé à l’instant tout comme l’orgueil des hommes.
Alors je me réfugie dans les paroles des amis. On médite ensemble sous les crépitements de l’eau, on s’assoit au bar de notre camp de base, on se voudrait marins qui remontent vers la source, on partage aussi l’histoire de nos origines.
Voyageurs stupéfiés par la beauté du monde, nous buvons nos dernières illusions sur la grandeur humaine.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 58 — 26/06/2022
Ne voulant pas vivre en ingrat, je voudrais à l’instant remercier un ami fidèle que j’ai emporté avec moi. Je vais ici rendre hommage à son extrême simplicité, sa précieuse durabilité (je l’ai acquis jadis et naguère en un lointain moyen-âge qu’une génération récente aurait bien de la peine à envisager, handicapée par sa phraséologie succincte et son vocabulaire atrophié*), sa tête tournante (veuillez ici reprendre le fil du récit) et son courage qui m’ont toujours accompagné, facilitant ainsi mon quotidien de voyageur déboussolé lorsqu’il ne peut se connecter. Ouf, j’y suis arrivé.
Ô ami de plastique, tête chercheuse toujours pratique, tu as l’art de ne jamais lâcher prise lorsque j’ai la mauvaise surprise de ne pouvoir brancher le chargeur de l’une ou l’autre petite machine qui à toute heure, est nécessaire à mon bonheur de voyageur en connexion avec l’ailleurs. Ou beaucoup plus simplement, tu me permets de conserver ce sourire étincelant, plus blanc que blanc, ainsi que mon hygiène buccale en rechargeant ma brosse à dents. C’est épatant.
Aussi, ami incomparable, complice de mes plus belles balades, je te rangerai lors de mon départ dans une pochette douce et soyeuse, pour que nous vivions ensemble d’autres virées heureuses. (Car je compte bien revenir : il y tant de choses à construire.)
Compagnon irréprochable, tu m’as appris cette qualité admirable qui est celle de l’adaptation, lorsque nous voyageons.
* Allusion fine et subtile à de récents évènements en cette France en déshérence qui m’ont touché autant que navré. Nulle envie de fustiger la bêtise, d’isoler jeunes ou vieux les traitant en idiots, mais plutôt d’apporter ici et là, la joie des mots entraînant des pensées nouvelles capables par leurs vertus thérapoétiques, de soigner nos maux.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 57 — 25/06/2022
Mon bon vieux Joachim, je suis comme ton Ulysse qui termine son voyage et j’aurai bientôt la joie de revoir mon village, de dormir sous le toit de ma belle maison en me demandant si j’ai eu bien raison de m’en être allé faire tourner des ballons sur mon nez.
Crénom ! Voilà t’y pas que j’mélange les bonnes tunes. Pantoute ! C’est que j’ai autant envie de rentrer que de rester. Car c’est à la fin de mon séjour que viennent toutes les belles rencontres, que poussent les germes d’amitié qu’il va falloir bientôt quitter. Mais je me dis que les chemins qui parcourent ce monde, pour les nomades de la vie, se recroisent un jour, là-bas ou ici.
Alors, c’est un peu une fête. J’irai encore me promener le cœur tout gonflé d’amitié. Et ce soir, j’ai été dîner (ou souper, c’est comme vous le voulez), chez l’ami Jules qui m’accueille avec son sourire solaire même si dans le restaurant, il n’y a pas beaucoup de clients. Il faut que Montréal qui est distrait et se remet des périodes léthargiques et tragiques découvre avec ravissement son grand talent.
Moi, je suis heureux et même fier d’avoir été pour quelque temps, son fidèle client !
Jules me propose la dégustation, assis au bar. Je suis hilare. Je le regarde travailler. On se raconte des histoires en dégustant un vin nature venu de Loire, légèrement pétillant et tout à fait charmant.
Il m’apporte bientôt une assiette dressée joliment, graines de moutarde marinées, fraîches herbettes entrelacées dissimulant un vrai trésor : son fabuleux tartare de saumon. C’est beau. C’est bon. Les consistances bien moelleuses contrastent divinement avec les fines tranches de brioche toastées un bref instant.
Il me confie des petits secrets. Sa grande passion pour les textures et cet amour qu’il met dans son art culinaire pour faire naître chez ceux qui y gouteront, de belles émotions. Chaque plat qu’il compose est une sorte d’aventure qu’il prépare patiemment à la maison, entouré par sa blonde et leurs p’tits rejetons.
Si Jules est jeune, il est déjà sage. Et je crois bien qu’il conquiert la Toison. Nous nous reverrons.
Il faut s’en aller déguster les jeudis et vendredis en soirée au Vin Public, Café Pista, 1587 boulevard Saint-Laurent, Montréal.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 56 — 24/06/2022
Je relève un instant la tête du guidon, car j’arrive peu à peu au bout de mon séjour. Est-il trop long ? Est-il trop court ?
J’ai recueilli dans ma besace tellement d’images, tant de phrases, des mots jolis, des silences et des absences aussi, les doux sourires de vrais amis, la certitude que mes racines sont loin d’ici, mais qu’il faut toujours se remettre en selle pour voyager vers l’ailleurs même s’il n’est pas meilleur. C’est une chance de s’enrichir des différences. Et je suis bien persuadé que l’humain est fait pour se déplacer. Résistons chaque jour davantage à tout ce qui voudrait nous immobiliser.
Mais que vois-je ? J’abandonne un moment ma bicyclette symbolique dans une ruelle de Montréal, je la retrouve qui s’étale.
La roue avant a-t-elle fondu ? A-t-elle voulu se réinventer en tentant de rejoindre le carré, se pliant déjà en deux moitiés ? Serait-ce là la pratique tragicomique d’un vélocipède épileptique ?
Je crois plutôt au simple drame provoqué par un chauffeur dépourvu de cœur qui a écrabouillé la fragile mécanique avec son camion. Le con. Désormais, elle ne pourra plus avancer qu’en glissant du même côté. Mille tonnerres, ça me pogne les nerfs ! Je ne suis pas de ces pépères qui veulent toujours tourner en rond.
J’en perds quelque peu les pédales. Comment vais-je me remettre en selle ? Le coup de pompe me guette et je redoute l’engrenage. J’enrage.
J’envoie au diable ma frustration. J’irai à pied et en avion.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 55 — 23/06/2022
Le fera-t’y, le fera-t’y pas ? Avouez que c’est bien tentant. On retrouve sa joie de petit garnement, celui qui appuyait sur toutes les sonnettes ou jetait des pétards dans les boîtes aux lettres.
Voici revenu le temps des grosses bêtises grâce à cette proposition exquise : il est interdit de passer, mais la chaîne si basse permet de sauter. On dirait bien que les propriétaires, un peu pervers, l’on fait exprès.
Je franchis la barrière, hop là. Je retombe derrière, hop là.
J’attends quelques instants la réaction promise. Je ne suis pas déçu, voici une grosse dame en chemise brandissant un balai. Un petit chien aboie et mordille ses mollets. La poursuite s’engage comme il le fut prédit. Trottine derrière eux un livreur et ses cruchons de lait, le facteur chargé de ses paquets, une demoiselle qui bat des cils et son amoureux imbécile, un canari, un chat et un crocodile, trois messieurs en haut de forme, un fumeur de cigares au ventre énorme, douze policiers moustachus roulant des yeux furieux sous leurs sourcils broussailleux, un bagnard évadé en costume rayé qui porte son boulet, un cowboy et ses pistolets, des pâtissiers et leurs tartes à la crème qu’ils projettent en riant sur les furieux agents. Ça roule. Ça s’écroule. Ça se remet debout et veut m’attraper, mais j’ai pris mes jambes à mon coup. Je dépasse Charlot qui rêve, Laurel qui pleure, Hardy qui rit. Buster grimpe à l’échelle de la voiture de pompiers. Il me faut encore accélérer. Moteur ! Je tourne.
La poursuite s’engage dans la rue Saint-Denis. Derrière moi pétaradent les vieilles automobiles et grincent les bicyclettes. Dring, dring. Pouet, pouet. Le spectacle est gratuit. Le public applaudit.
J’entends derrière moi les ratés du projecteur. Je perds un peu mon souffle. Je sens battre mon cœur. Tandis que je marche, l’action ralentit.
Je vais rester muet, mettre un point à la ligne. Il faut savoir faire d’une interdiction, un film.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 54 — 22/06/2022
J’ai depuis longtemps l’intuition des coulisses. C’est peut-être pour cela que j’aime les venelles, les chemins de traverse, les rues qui longent l’arrière des maisons dévoilant des jardins laissés à l’abandon. J’explore curieux, lors de mes promenades, ce qui veut se cacher derrière les façades. Et en grattant un peu, ici comme ailleurs, si la beauté t’éblouit, tu aperçois aussi les traces du malheur.
Je longe un terrain bien trop vague en plein centre de la ville et j’y salue l’autochtone comme on l’appelle ici. Elle me lance un sourire édenté et un juron qui doit être bien salé. C’est une petite femme dont je ne perçois pas l’âge. Est-elle jeune, est-elle vieille sous ces rides crasseuses ? Elle s’incruste au trottoir. Elle s’accroche à la terre qui est sienne, sous l’asphalte et les flaques de bière.
Son territoire a été recouvert par la ville qui en a bouffé la nature dont elle fut chassée. Elle n’a pas compris malgré le temps passé et ses ancêtres décimés qu’elle devait se tirer, aller voir ailleurs et bien mieux, disparaître.
Un matin prochain, on ne la verra plus. On s’étonnera un peu. On dira que c’est triste et qu’elle avait trop bu. On ne dira sans doute rien du tout. Elle ne sera plus là, c’est tout.
Car il n’y a pas de place non plus pour elle dans les statistiques. Elle ne fera pas même partie du drame de la violence faite aux femmes. Elle se dissout depuis longtemps dans cette marginalisation multigénérationnelle et intergénérationnelle qu’entraînent la pauvreté, le logement précaire, l’absence de domicile fixe et tous les obstacles à l’éducation, l’emploi, la santé et le soutien culturel.
Voilà les mots de vertueuses études qui ne parviennent pas à masquer qu’elle fut jetée à la poubelle lorsque les politiques coloniales et patriarcales ont annihilé tout ce que son peuple fut.
Aujourd’hui le langage des fonctionnaires est bien plus poli et recouvert de son verni humanitaire pour faire de bonnes affaires. Tourne la machine qui toujours assassine.
C’est peut-être plus inhumain encore de justifier la situation, par le manque de moyens et les budgets dérisoires, qui ne permettent pas de sauver quelqu’un, perdu sur un trottoir.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 53 — 21/06/2022
Marie-Jeanne avait ses vapeurs. Elle descendait nonchalante et fumeuse le boulevard Saint-Laurent qui était à la fête. Il fait si beau en juin.
La belle dame s’évaporait, laissant derrière elle ses fragrances d’herbes de Provence. Elle était bien cuite, souriant aux anges qui l’avaient prise sous leurs ailes et qui l’aidaient à planer par-dessus les nuages. Y’a pas d’âge ! Et Marie-Jeanne, qui n’est plus si jeune, ne sera jamais sage.
Elle accompagne tous ces artistes en herbe à qui elle offre par sa présence un peu d’assurance et l’intuition soudaine de leur génie. Mais avec tant d’anges dans les parages, gare à la chute ! La création hallucinée se révèle souvent, à jeun, plutôt loupée. Qu’importe, on aura quand même bien rigolé.
Parmi les effluves et les sourires gentiment imbéciles, je magasinais donc tranquille, admirant au passage les psychédéliques messages, les tableaux trop colorés, les teeshirts sérigraphiés.
Je suis tout à coup surpris par des restes et des débris enfermés comme de la joaillerie dans le caisson encore entier d’un vieux computeur démantibulé. Je suis touché, me souvenant de ce temps pas si lointain où je sacralisais le corps de l’ordinateur cristallin dont je voulais croquer la pomme pour accéder à la connaissance comme tenté par le malin.
La belle trouvaille : pomme de reinette et pomme pourrie. Voici venir l’appel à la quincaillerie. Apple, on va t’avoir jusqu’au trognon et récupérer tout ton pognon pour la planète débarrasser de ton commerce carnassier. De la carcasse de tes sacrés appareils, commençons à créer de nouvelles merveilles.
Mais voilà le pépin : tapotant ces derniers mots sur mon clavier de la marque abhorrée autant qu’adulée, je me retrouve désappointé devant cette perception de mes contradictions. Allons, ce n’est pas que pour ma pomme : le paradoxe est commun à tous les hommes.

Chronique poétique d'un voyage à... Québec 52 — 20/06/2022
C’était ma dernière soirée à Québec. J’ai cherché la rue. Je me suis bien trompé. Il faut savoir aussi rebrousser chemin, revenir sur ses pas et remonter le temps pour tenter de donner du sens même à ce qui n’en a pas.
Calme, très concentrée, Madame Louise Depré attendait dans la salle, déjà installée. Cela s’agitait autour d’elle, mais à pas mesurés. Impatience feutrée. On chuchotait en n’osant déranger.
Les musiciens s’accordaient. J’entendais en coulisses, les notes glissantes d’une clarinette lisse tandis que sur scène, violoncelle et violon haussaient un peu le ton. On se souriait, complices.
Le public arrivait, s’asseyait sagement. La plupart se saluaient fraternellement. Le silence se fit.
Les mots et la musique s’enlacèrent dès que le jeune chef en eut demandé l’envol. Puis ce fut l’effrayante beauté des choses qui entrent en conjonction.
La dame poétesse qui perçut l’innommable, là-bas à Auschwitz et Birkenau, a lu très calmement ses mots simples et beaux, écorchant les mémoires, ravivant ce chaos que l’on ne veut pas voir et que certains même refusent de croire. Le piano enchaîné criait ses discordances évoquant tant et tant de souffrances et la macabre danse des biberons brisés dans ce massacre de l’enfance.
Je frémis en pensant aujourd’hui à ces pays où l’horreur recommence et à tous ceux où elle ne finit jamais.
Mais il n’y eut rien de morbide ici. Il s’agissait en dansant d’oser frôler l’abîme, d’avoir la dignité de regarder en face ce que produisent le vide et la terreur des idéologies stupides et cupides.
Les mots et la musique ont évoqué le chaos pour s’en extirper peu à peu en dansant plus haut que les flammes. Merci aux mots de la dame. Une harmonie s’est imposée comme le miracle que nous sommes capables de créer, parfois. Elle a renforcé notre conscience d’être simplement humains et le courage de travailler chaque jour à l’être davantage. Comme je voudrais que nous soyons plus nombreux à refuser le carnage.
Livre : Plus haut que les flammes de Louise Depré
Musique : Nicolas Jobin

Chronique poétique d'un voyage à... Québec 51 — 19/06/2022
Les oiseaux de passage s’accrochent à leurs bagages et ne font pas attention à elle bien qu’ils picorent distraitement ce qu’ils lui ont commandé. Matelot corvéable d’un navire immobile, elle regarde les autres partir loin de la gare des autocars. Ceux qui arrivent ne s’arrêtent pas dans sa taverne moderne. Ils ont mieux à faire.
Je lui demande un café même si je sais qu’il ne sera pas bon.
Que voulez-vous ? On se réchauffe comme on peut lorsqu’il faut bien tuer ce temps que l’on sait pourtant si compté.
Je voudrais être un peu gourmand, mais je me retiens de désirer un croissant. Il a des reflets de plastique sous la vitre du comptoir. Tout ici est plastifié, hygiénique, mécanique.
Les distributeurs de liqueurs sont automatiques. Mon horaire est lisible sur le panneau numérique. Je paye avec ma carte électronique. Nique. Nique.
Elle dépose mon café près de la caisse. Carte de débit. Carte de crédit. Ses yeux voyagent ailleurs et je ne suis pas certain qu’il soit bien meilleur.
Comme je la remercie et ose un sourire, je la vois un bref instant qui se décille. C’est un éclair de calme lucidité. Elle sort de sa cachette comme un petit trésor, un sucre blond de canne pour adoucir mon café. Mon breuvage en sera un petit peu amélioré. Il faut parfois savoir édulcorer. Je n’ose en partant, lui souhaiter une bonne journée.

Chronique poétique d'un voyage à... Québec 50 — 18/06/2022
Il est temps de mettre le point sur le i, surtout si celui-ci est parti. Vous avez remarqué ? Il faut lire l’image qui soudain ne parait plus très sage. Et même bien stupide, exaltant l’habitude du cupide.
Je m’explique : voilà qu’en rentrant ce soir d’un petit restaurant bien charmant qui combla mes attentes de gourmand, je me réjouissais encore du privilège de pouvoir bien manger, de me cultiver, d’avoir du temps pour penser et pour rencontrer des gens attentionnés, passionnés de surcroit par ce qu’ils créent. Passant devant le palais Montcalm, tout éclaboussé de lumière, celui-ci me proclama son curieux programme : « Ensemble, nous redevendrons ».
Manque le i, j’ai bien compris. Mais n’est-ce pas beaucoup plus clair ainsi ?
Car ce message très naïf, censé sans doute nous rassurer en ces temps où nous ne pouvons que douter, voulait nous annoncer un retour proche aux habitudes : consommation des produits culturels, consumation des ressources naturelles.
Mais c’est fini, les amis ! Il va falloir cesser de vendre. Voilà ce que ce slogan peut paradoxalement nous apprendre. Le désir de revenir à la normale, qui était déjà une situation anormale, est la folie qui nous entraine droit au tombeau. Faut changer illico de créneau.
Je me dis qu’il est temps de retrouver ma boutique de petits pots éthiques, mon magasin qui récupère et ne vend rien. J’ai l’intuition d’un changement radical. Proclamons le rêve général.
L’ art et la poésie ont depuis longtemps tracé des chemins loin du monde marchand. Mon utopie est de les choisir pour rester vivant.

Chronique poétique d'un voyage à... Québec 49 — 17/06/2022
N’ayant pas les ailes d’un ange ni la moindre trottinette, c’est à pied que j’arpente la bonne ville de Québec. Mon cœur bat, travaillent mes mollets, je suis heureux d’arriver à mes rendez-vous avant d’être sur les genoux.
J’évite la mauvaise pente, sachant qu’il faut toujours remonter et tourne de préférence à gauche (si cela a encore un sens) pour approcher l’humanité.
Les gens que je rencontre s’arrêtent comme moi pour reprendre leur souffle en riant. Nous grimpons alors ensemble en parlant un petit peu moins, les escaliers serpentant entre les maisons penchées qui nous saluent au passage, fières comme nous de tenir toujours debout.
À l’abri du soleil, dans des bureaux plus sombres, nous dégustons l’ombre, un verre d’eau, nos jolis mots et des ribambelles d’idées nouvelles.
Sur le toit d’un immeuble transformé en potager collectif, j’ai semé des projets. Au cœur d’ateliers préparant l’avenir qui sera poétique et éthique ou ne sera pas, j’ai rêvé d’imprimer sur les presses séculaires, des dessins pour demain.
C’est par la création que nous trouverons des sentiers nouveaux pour le monde à venir s’il y a un avenir. Et ces lieux de passion ont bien raison de faire bonne impression typographique ou numérique.
Le temps passe et nous menace. Nous portons nos angoisses. Mais il faut toujours marcher à Québec comme ailleurs et sentir les battements réguliers de notre cœur.
Chaque pas que nous faisons nous entraîne à la création.

Chronique poétique d'un voyage à... Québec 48 — 16/06/2022
Le touriste est un mammifère migrateur et grégaire, se déplaçant généralement avec sa femelle et sa progéniture accablée.
Dépourvu de flair, le mâle suit les traces de ceux qui le précèdent ou l’itinéraire indiqué par son téléphone cellulaire. Il aime rejoindre le troupeau qui erre sur des territoires propres et balisés. Il les marque en les souillant de ses papiers gras, cannettes et autres déjections.
Les éthologues urbains, munis de balayettes et de patience, passent derrière lui pour redonner à la vieille ville qu’il prend pour un parc d’attractions, s’inquiétant parfois de l’heure de fermeture, le lustre qu’elle n’eut jamais et qui la fait ressembler à un décor de plastique immaculé. Le touriste aime. Il déguste ainsi une portion d’Histoire édulcorée.
Amateur de babioles et de colifichets, il explore en souriant la boutique de souvenirs, absorbe avec gourmandise tout ce qui fait injure à la gastronomie et écoute au bord de l’extase, le musicien de rue qui massacre des standards sur une rythmique binaire préenregistrée. Dépourvu également d’une ouïe bien développée, le touriste aime quand cela joue bien fort.
Il apprécie l’art, mais évite les musées, préférant la galerie de croutes dont les tableaux tartinés d’épaisses couches de peinture multicolore, prouvent que l’on n’a pas lésiné sur la marchandise. Le touriste exige d’en avoir pour son argent.
Enfin et par-dessus tout, le touriste adore le frisson de l’aventure soigneusement organisée. Il harangue sa meute quand le temps est venu. Madame trottine. Les enfants se trainent. Il rappelle l’horaire.
Il embarque vaillamment avec sa troupe, pareil aux conquérants des siècles passés, sur un solide navire capable d’affronter les dangereux courants du fleuve Saint-Laurent. L’œil sévère, le foie barbouillé, il surveille sa femme et engueule ses enfants pour que dans l’innocence de leur jeune âge ou l’insolence de leur adolescence, ils ne commettent pas la sottise de basculer par-dessus le bastingage.
Un peu rassuré, il se campe fièrement pour faire un égoportrait au milieu du pont. Il ne se doute pas qu’à Québec, il y a des canons.

Chronique poétique d'un voyage à... Québec 47 — 15/06/2022
Au cœur sensible des institutions dont je ris parfois à tort ou à raison, il m’arrive souvent de rencontrer l’humain qui ne se cache pas sous le masque de sa fonction. Soyons plus précis et aussi plus honnête. Je dois écrire humaine, car les hommes s’accrochent bien plus et avec un orgueil bête à la petite étiquette qu’on leur a collée dessus.
Mais basta ! Durant mon beau voyage, je suis confronté à un bouleversement des genres qui fait avancer ma pensée. Nous sommes en mutation. Du moins je le souhaite pour éviter l’inéluctable autodestruction. Et si mon écriture n’est pas inclusive, c’est que j’aime encore sa petite musique et qu’en vieux musicien je cherche sa rythmique. Mais je sais que ma langue est vivante, elle prend son temps naturellement et on peut l’aider évidemment, pour s’extraire peu à peu de la culture patriarcale bancale, qui ne tient plus debout, dont nous percevons les derniers soubresauts et les terrifiantes régressions qui entraînent en ce moment même l’humanité au tombeau.
J’aimerais, débarrassé des clichés, revenir au madrigal, oser le petit compliment. Peut-être en notre époque est-ce vraiment marginal ? Car il me faut écrire aux dames que j’ai croisées combien je les ai appréciées. Il s’agit ici d’exprimer de la gratitude. Cela non plus n’est pas dans les habitudes.
Prônons encore et beaucoup plus loin cette révolution douce qui face à Thanatos propose la force d’Éros. Hélas ! On confond souvent tout, mettons tous nos tabous à genoux, pensons au-delà de la séduction et causons de nos cultures dans la tendresse et la délicatesse sous le soleil de nos sourires.
Osons enfin faire l’humour, tous ensemble, au moins trois fois par jour. Le monde irait bien mieux si nous riions un peu. Rien n’est plus sérieux.
J’ai vu passer sur le visage de ces dames amies, sourire et ironie. Je crois plus que jamais à ce que nous construisons peu à peu ensemble : ces barricades de joie et ces ponts aériens qui préservent l’humain.
Partageons s’il vous plait et le plus souvent possible, nos cultures différentes et l’intelligence sensible.

Chronique poétique d'un voyage à... Québec 46 — 14/06/2022
Meubles qui craquent et moi aussi. J’ai rendez-vous avec la beauté, ici. J’aimerais bien, ce matin, définir ce sentiment-là qui se révèle quelques fois lorsqu’on se pose au bon endroit. Et vous, qu’en pensez-vous ?
Ils sont curieux ces beaux instants suspendus dans le temps. On s’arrête, on s’assoit, bien sûr on ne parle pas. On déguste le silence. La solitude est même préférable pour que tout puisse se mettre en place et atteindre l’admirable. Et parfois l’improbable.
Mon chemin hasardeux m’a conduit ici, dans cet appartement d’un temps révolu. Je suis si disponible qu’ils ont osé s’approcher.
Je passe parmi eux. Ils glissent silencieusement, amoureusement, sans un bruit. Leurs mains, qui ne touchent plus rien, effleurent les vieilles boiseries. Ils s’enlacent et se confondent parfois, comme retrouvant brièvement ce qui les avaient unis.
Il y eut des parfums, des histoires de famille, des amants éconduits, des passions étouffées, de l’amour aussi qui a fleuri et donné des fruits. Le temps est passé. Les humains disparus hantent gentiment le corridor, leur ombre fugace s’accroche aux persiennes qui tamisent la lumière et ils passent derrière moi, bienveillants, tandis que j’écris. J’ai aperçu les robes fleuries, un fumeur de havane, de l’alcool interdit.
Un vieux swing alangui grésille dans une radio qui n’est plus. Je le fais renaître par le souffle très doux de la clarinette. Les tendres fantômes dansent au ralenti, me saluent au passage. Et je vois dans leur sourire un peu triste l’envie de la vie.
Elle s’enracine ici. Le passé la nourrit. Je me lève et m’apprête à poursuivre la mienne. J’ouvrirai bientôt la porte de rue pour plonger dans la ville pleine de bruit, pleine de vie. Je poserai les pieds sur le trottoir éclaboussé de lumière et me laisserai entraîner par le courant, nageant dans les ruelles de ce vieux Québec qui tangue vers son fleuve.
Mais à l’instant, je remercie les vénérables amis qui, dans cet appartement, m’ont si bien accueilli.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 45 — 13/06/2022
La littérature est une sorte d’aventure vivante et permanente. On la croit parfois momifiée par le snobisme, empaillée par la notoriété, mais elle a l’art du pas d’côté, de la rature, du pied de nez. Lorsqu’elle se sent trop à l’étroit, étouffée par ceux qui s’y croient, elle va voir ailleurs pour être meilleure. Elle est pareille à la poésie, sa sœur de cœur, qui est l’autre mot pour dire la vie comme le gazouillait si joliment le plus formidable moineau de Paris.
De cela et de bien différentes choses, je papote avec mon ami qui tient la buvette du square Saint-Louis. J’écris buvette mais je pourrais causer d’un palais miniature où le voyageur de passage vient ici narrer toutes ses aventures.
Il sert un bon café et propose justement de déguster à l’instant une tranche de vie. On le sait que ce n’est pas tous les jours du gâteau, qu’on ne ramasse que des miettes et que c’est du boulot.
Faut parfois aller loin pour trouver son chemin. On peut dire qu’il en a fait, mon copain.
Berbère, son choix fut de partir en errance pensant adéquat de passer par la France, croyant bonne pomme au pays des droits de l’homme. On le sait qu’on peut-être bien là-bas, mais que ça dépend pour qui et pas forcément pour toi. Là comme ailleurs, la tendance est revenue d’isoler l’être humain à une seule identité. C’est raté. Les beaux idéaux ont quelque peu moisi. Cela aurait même tendance à sentir le pourri.
Il n’en veut à personne. Il a repris la route, cherchant simplement le lieu où se poser un peu et tenter d’être heureux.
Désormais il sourit au cœur du carré Saint-Louis. Du moins quand le soleil est là, car quand vient la pluie, il reste chez lui. Il est devenu presque sage, mon ami.
Il connait le chanteur, le cinéaste, l’écrivain qui parfois s’assoit là sur un banc pour tenter un instant de remonter le temps. Tout le monde aimerait retrouver un peu de sa jeunesse, ses élans, ses ivresses, qui ont fané près d’ici, dans un café perdu de la rue Saint-Denis.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 44 — 12/06/2022
Voulant préserver ma fraîcheur, à un certain âge on soigne son image, je décide d’aller chez le coiffeur. Une jeune dame virtuose du ciseau, reine de la tondeuse, fille de Figaro, m’accueille, me prend en charge subito. Je vous l’avoue, je ronronne et fais le gros dos, illuminé par son sourire et son accent pointu venu de Virginie.
La séance commence et je suis charmé. D’autant plus qu’en me coiffant, elle n’arrête pas de parler dans un Français chantant.
Tandis que ses doigts agiles me tripotent le crâne, elle me surprend soudain en parlant de bibites infâmes. On ne se sait jamais où ces conversations qu’on engage avec des inconnus vous emporteront. Mais je comprends enfin qu’elle me dit craindre du maringouin la redoutable piqûre capable selon elle de lui déformer la figure.
Je compatis et avoue que ce serait bien dommage, mais elle m’entraine plus loin et à l’instant me partage son aversion autant que sa fascination, pour les bébêtes angoissantes.
Je ne connais rien de la Mouche Sarcophage, de l’Araignée Loup, du Crotale des Bois, mais voilà que soudain comme sorti d’un monde sauvage, un bestiaire creepy grouille sur mon crâne.
La charmante coiffeuse ne serait-elle pas sorcière ? Je suis à sa merci dans ce fauteuil de cuir, je n’ai pas mes lunettes, impossible de fuir. Et ses doigts plus nerveux gambadent sur ma tête. Sont-ce d’ailleurs ses mains ou n’a-t-elle pas invoqué un absurde démon aux pattes arachnéennes qui fait des siennes ? Ce qui me reste de cheveux sur le chef se redresse derechef.
Mais l’histoire est finie et la séance aussi. Je me lève de mon siège un peu abasourdi. Remettant mes bésicles, tremblant sur mes guiboles, je crois voir dans un coin fuir une bestiole.
La coiffeuse me demande si je suis bien content. Je confirme trop fort mon état bienheureux. Et j’emporte avec moi son sourire malicieux.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 43 — 11/06/2022
Les hirondelles ne font pas le printemps depuis qu’elles ne circulent plus en bicyclette. Les temps ont changé. Et je ne vous dis pas pour autant que c’était mieux avant, monsieur l’agent. On en a connu des bastonnades, des ratonades, des passages à tabac, des matraquages d’étudiants, des étouffements de migrants.
Je ne vous provoque pas, j’énumère les dérapages incontrôlés de la maréchaussée. D’ailleurs, je ne suis pas fou : je ne vous dis rien et ne parle qu’en présence de mes propres défenses. L’interrogatoire permanent, je le pratique seul.
Je marche dans le sens du courant sur le boulevard Saint-Laurent, comme l’agneau de la fable, innocent. Ils sont pareils à moi, tous les promeneurs qui passent là, le cœur à la fête, bière qui monte à la tête, un p’tit coup d’vin dans l’nez ou bien d’fumette. Ça rigole et ça fait quelques galipettes. C’est la braderie, la ducasse, l’exutoire qui déborde des trottoirs.
Excusez-moi, mais votre présence refroidit l’ambiance. D’autant plus que je viens d’apprendre qu’en France, vos collègues quelque peu pressés n’hésitent plus à tirer, tragique façon de régler la circulation sans sommation.
Je ne veux pas faire d’amalgame, mais j’ai peur de vos armes.
Vous avez l’air si jeunes ! Ce n’est pas un défaut, mais avez-vous la sagesse et la formation pour gérer tout ce stress, comprendre les mutations, l’atmosphère délétère de la misère et porter cet immense fardeau que, comme un gilet pare-balle, on vous fiche sur le dos ?
Pour moi, une seule chose est claire : rien ne justifie que l’on sacrifie, ne serait-ce qu’une fois, une vie. Retenez au moins cela au milieu des médias qui aboient, même lorsque vous affronterez une violence ennemie. Quand vous ferez face à la détresse, dégainez s’il vous plait, une dose de tendresse.
Mais je vais circuler comme vous me l’enjoignez. Je vais porter plus loin mes belles utopies, mes capsules d’espoir, mes graines d’empathie.
Circulons, circulons. Il y a tant de choses à vivre et à voir. Bonsoir.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 42 — 10/06/2022
Le square Saint-Louis, c’est le domaine où pleure ma mélancolie. Jour de pluie, la fontaine s’ennuie. Higelin n’est pas loin ni tous ces poètes qui ici se sont assis, y ont posé leur auguste derrière comme Monsieur Laferrière.
Pardon, pardon, je ne suis pas respectueux, mais il pleut. Et puis quand je me frotte à un mythe, je me questionne et médite. Car enfin, qu’ai-je vu icitte ?
Quelques gentils fumeurs de joints, de pétous, de bedos, de tarpés, souriant béatement dans les volutes de leur fumée dont la simple fragrance me fait déjà planer. Cannabis, cannabis, qu’ici tolère la police.
J’ai vu se baigner dans la fontaine une véritable sirène, tatouée de haut en bas, entraînant les p’tits enfants dans ses ébats.
Il y eut ce glorieux clochard, chantant trop fort sa propre histoire, lassant bien vite les badauds qui préféraient aller s’asseoir loin des trémolos du Figaro.
J’ai observé les gros pigeons se becqueter comme les jolis amoureux jamais rassasiés de leur soif printanière, s’enlaçant infiniment en riant des écureuils qui voudraient bien en faire autant, mais qui s’en vont caracolant perdre leur temps.
J’y ai bu un bon petit café, causé aux gens en les regardant passer : des jeunes, des vieux, des beaux, des laids, de jolies femmes en p’tites jupettes, des gros mollets, des robes longues, des salopettes, des hommes d’affaires très pressés, des étudiants un peu paumés.
Tout ce p’tit monde n’est que de passage.
S’asseoir sur un banc du carré Saint-Louis peut être sage : tu vois passer la vie et comprends que tu en fais partie.
Trempant ta plume dans ce flux permanent, tu pourrais écrire un roman.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 41 — 09/06/2022
Mon bon Julos, toi qui as mis il y a quelque temps des ailes à ton vélo pour aller voir le monde d’en haut, tu sais-tu ou tu sais-tu plus rien que j’ai croisé tes mots sur mon chemin ?
C’était à ce coin de rue que m’avait indiqué l’agent 15, godverdomme ce bon Vertommen, qui faisait comme un gamin des galipettes sur sa bicyclette. Klet Mariette. Zut et flûte ! Quick et Flupke !
Manquerait plus qu’un cornet d’frites, sauce pickels ou andalouse, pour que je retrouve mes habitudes, les belles paroles de mes Marolles, ma tendre amie en Wallonie, ma p’tite belgitude et ses incertitudes. Mais non, je caricature, à cause d’Hergé, encore une fois. Des frites, je n’en mange que…parfois.
Et là, je suis à Montréal, la bonne ville du Québec qui me cloue le bec :
- Hé quoi, niaise-moi pas, t’as pas d’affaire à faire ça, tu l’savais donc pas qu’ici le Beaucarne était roi ? Le genre grand-seigneur, poète voyageur, copain avec Gilles Vigneault, de notre langue le héraut ?
Je reste coi au bord du trottoir. Cela m’en coute, j’vous prie de le croire. Mais je sens bien que je vais en faire une histoire. Il suffit que je marche encore un peu, les mots me suivent à la queue leu leu. Et tout le quartier devient piétonnier. Finie, la dictature des petites et grosses bagnoles, voici venir l’ère des guibolles.
Julos l’avait prédit en bon poète visionnaire : « La Révolution passera par le vélo, camarade ».
Je le salue et puis poursuis ma promenade. Je rêve de ma bécane monoplace décapotée au cœur du vent.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 40 — 08/06/2022
Il faut bien des miracles pour qu’existe un livre
D’abord on doit l’écrire et ce n’est pas du gâteau
Faut arrêter le temps, souvent se lever tôt
Ce n’est plus un travail, mais une façon de vivre
Qui enivre
Ensuite il faut re-re-re-lire et encor’corriger
Se remettre tant de fois à l’ouvrage
Sans jamais s’essouffler ni perdre ce courage
Qu’il nous faudra encore pour oser l’envoyer
Ce n’est pas gagné
Vient alors cette étrange relation
Qui se fera peut-être avec un éditeur
Ça vous fait parfois mal, ça brise votre p’tit cœur
Et le plus emmerdant c’est quand il a raison
Faites attention
Et pis ce n’est pas fini, faut encore l’imprimer
Choisir avec amour une belle typographie
Et si c’est nécessaire son iconographie
Ce n’est pas très coton, car il n’y a plus d’papier
Faut en trouver
Alors voilà, le livre est là, tout frais, tout beau
On en parlera une fois à la télévision
On l’achètera un peu si on retient son nom
Seulement quelques-uns liront vos jolis mots
Si vous avez du pot
Et puis un jour dans une boite à livre
Perdue dans une ville que vous n’connaissez pas
Vous le découvrez : quelqu’un l’a enfermé là
Pour qu’un lecteur nouveau gratuitement le délivre
C’est vraiment un miracle, un livre

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 39 — 07/06/2022
Il n’a pas la moindre hésitation. C’est un cador, un vrai champion en complet veston. Il indique la bonne et unique direction, celle qu’on a toujours suivie pour être mieux, engranger du profit, monter plus haut, aller plus loin, préparer demain en écrasant le présent. Il hypnotise et il convainc.
C’est regrettable, il reste quelques vieux non rentables, des enfants qui perdent leur temps en se blottissant dans les bras de leur maman et puis tous ceux qui sont tombés et qu’il ne faut surtout pas aider à se relever. Enfin, il y a des insolents qui regardent ailleurs, de vrais rêveurs, et qui se demandent s’il ne serait pas urgent de penser autrement, d’arrêter le mouvement presque inconscient, de respirer un peu, de laisser à la vie tant qu’il en reste encore, le temps de rejaillir au milieu des gravats et de tout ce qui est déjà mort.
On sent dans la fusion de polyuréthane, un début de discorde. On sait qu’il pleut des cordes là-bas et des tonnes de bombes, que des corps se disloquent, que les pires instincts abolissent l’humain. Toujours la même chanson de la chair à canon, tandis que les entreprises qui capitalisent, trépignent et investissent dans le drame. On vend beaucoup d’armes. Et quand tout sera détruit, il faudra reconstruire. La guerre est toujours pour certains, une bonne affaire à faire.
Passe un frisson. La façade des banques n’est plus aussi lisse. Dans la foule apeurée, une majorité glisse et beaucoup ne peuvent nager même si la mer monte. On s’inquiète enfin de ce que devient le monde. Il va falloir chercher de nouvelles bouées.
Des bras se lèvent en se retroussant les manches, des mains se tendent en cherchant le tendre. Le troupeau des humains peu à peu se disloque. Il en est quelques-uns qui prennent d’autres chemins.
Ils trouveront peut-être une nouvelle façon d’être.
Sculpture de Raymond Mason, la foule illuminée, 1986
Placée au 1981, avenue Mac Gill Collège, Montréal

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 38 — 06/06/2022
Je ne sème plus de cailloux blancs dans les sentiers que j’emprunte, à peine des miettes, pour faire plaisir aux oiseaux qui les picorent. L’essentiel n’est pas de laisser des traces. On ne retourne pas en arrière. Et je ne veux pas que l’on me suive. Que chacune et chacun découvre ses chemins détournés ou apprenne à se perdre sans redouter l’impasse. Marchons au présent.
Ainsi, j’arrive quelquefois à un croisement de routes. J’y rencontre des promeneurs égarés et lucides qui ont pour tout bagage, leur langage. On s’assoit. On se dit qu’il était une fois. On écoute.
Vient l’histoire de Petit Jean et de sa princesse Perdrix perdue. Il a beau être chanceux chasseur, on a bien peur que le bonheur s’envole loin de lui. Il n’a pas choisi d’avoir une maman femme au foyer qui a depuis longtemps le désir enfermé dans le nœud bien serré de son tablier. Le conte passe, l’œdipe aussi.
On se trancherait bien une cuisse ou le vif du sujet, pour nourrir l’aigle afin qu’il nous emporte plus loin, auprès de notre blonde qui s’impatiente un peu de vivre des jours heureux. On fait c’qu’on peut.
Mais c’est la conteuse habile qui vole, volubile. Elle ouvre les ailes, plume dans les cheveux et yeux malicieux. On la suit, réjouis. Elle a bien d’autres histoires dans son sac. Elle les jette en pâture dans cette nature retrouvée où doit bien se cacher l’un ou l’autre lutin cruel et malin. Le blé pousse. On moissonne. On a toujours faim. Et on lui emboite le pas dans les sentiers sinueux de ses histoires et du Mont-Royal. On devient ami de la montagne dont le cœur bat sourdement sous nos bottines.
La bonne diseuse mâche et mâchouille ses chants anciens et ses refrains. Elle nous entraine un peu plus loin, plus profondément, près des racines qui sont communes aux humains.
Elle est l’enfant qui s’émerveille, la femme sage qui la nuit veille, la biche et le guerrier blessé, l’orpheline abandonnée, la folle aussi et la sorcière dont on craint un peu le mystère.
Sa parole est d’or et chaque mot qu’elle offre, fait danser son corps devenu coffre au trésor.
À la conteuse Nadine Walsh. Merci aux amis de la Montagne pour l’organisation de cette promenade contée.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 37 — 05/06/2022
Bonsoir, Monsieur et chapeau ! Vous êtes défunt, paraît-il, mais vous dominez la ville. Comme quoi un bon artiste est toujours un artiste mort. On peut exposer son corps et le mettre en façade, lui faire dire ce que l’on veut, le réinterpréter à volonté, en faire l’icône brevetée, image de marque agréée pour le touriste émerveillé.
Mais lorsque je passe près de vous, je ressens encore l’élégance de votre blues infini et doux, qui se balance. Dance me to the end of love. N’êtes-vous pas allé au bout de tout ? Des mots, de la vie, des aventures, des lits et de la littérature ? Hallelujah ! Votre voix éclaire les nuits les plus noires ou tamise les spotlights de la gloire.
Un violon chante la dérision, la joie, le drame, la déraison, façon klezmer, dans vos chansons. C’est un rythme ancien qui a survécu, enraciné dans le cœur des humains qui ont tout connu, de la pire désillusion à l’illumination, et qui ont compris de la vie, la tragédie. Marchons un peu plus loin puisqu’il fera beau demain.
Balance tes refrains. La ville pleure un p’tit crachin.
Je souris de la douceur de ton chagrin.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 36 — 04/06/2022
Elle penche franchement à droite, mais mon cadrage est-il objectif ?
Toujours est-il qu’elle s’accroche, la vieille demeure réactionnaire. Elle rêve, perdue au milieu du béton, des grues grinçantes et des grandes érections. Avec une nostalgie un peu douteuse, elle se remémore ses frasques d’antan, lorsqu’elle était jeune fille de bonne famille et recevait en souriant, les jeunes gens du même rang au thé dansant. C’était le bal des limousines, des robes en soie et à volants. On attendait le Titanic en dégustant un Manhattan (5 cl de rye whisky, 2 cl de vermouth rouge, 1 trait d’Angustura, le tout servi dans un verre à cocktail glacé et décoré d’une cerise au marasquin). Appuyé au grand piano qui jouait un peu faux, on s’ennuyait élégamment.
Le bateau a coulé. Un autre monde est né, accumulant les massacres de grande envergure, industrialisant la mort, grignotant inexorablement la nature et, accessoirement, imposé quelques droits sociaux. Voilà qu’il faut bien les loger, ces drôles d’oiseaux. On empile des cages pas trop loin de leur boulot.
La vieille demoiselle a gardé sa vertu, mais se retrouve bien penaude, accrochée à sa petite colline, encerclée par ces grandes volières qui s’ingénient à lui faire de l’ombre en espérant qu’elle comprenne que le monde a changé et qu’elle ferait mieux de dégager.
Elle demeure, têtue. Elle touche du bois, dodeline un peu, craque de la charpente, s’inquiète pour ses fondations, redoute la tuile, mais ricane en douce. Elle s’en fout : elle est classée. Faisant partie du patrimoine, elle tire la langue et fait la nique à toute politique urbanistique.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 35 — 03/06/2022
T’as pas d’affaire à faire ça. Quand la brunante envahit la ville et qu’t’as marché toute la journée, tire-toi une bûche, t’es trop tanné. Tu peux t’asseoir sur ton steak.
Icitte, tu vas reprendre des forces, perché sur ton p’tit tabouret en skaï de cuir de limousine. Le cul entre deux chaises, en équilibre entre deux mondes, rêvant aux chars de ton grand-père et aux jupettes de grand-maman quand elle dansait le rock’n’roll sur ses caoutchouteuses guibolles.
Je sais que je mélange tout, l’accent, les mots et les époques. N’est-ce pas cela le langage, ce coquetel improbable de nos vocables. Langue vivante, steak admirable ! J’en mangerais bien encore une tranche plutôt saignante, car j’en suis bleu ! Je suis gourmand infiniment de tous vos mots qui sont mes mets. Je les cuisine avec les miens pour que des saveurs nouvelles adviennent.
Effaçons toutes les frontières, libérons nos interjections, nos métaphores, nos mots d’amour. Il faut rouvrir nos oreilles et nos p’tits cœurs endormis, pour permettre à notre langage de nous offrir toutes ses images.
Nous allons baragouiner quequ’chose, provoquer la métamorphose de notre prose. Apportez donc votre grand-mère, gentille et chichiteuse grammaire, votre p’tit frère qui slame et rime et rame, la tantine qui transgenre les accords avec son corps, le tonton plus austère amoureux pointilleux du vocabulaire qui exige la précision de chaque locution et nos bien-aimés cousins déglingués, ivres du verbe, poètes illuminés.
Ensemble, dégustons le bouillon polysémique de nos syntagmes incongrus. Turlututu.
Nous sommes une grande famille, gourmande de sa phraséologie.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 34 — 02/06/2022
Elles sont partout, les p’tites machines. Elles ont le don d’ubiquité, elles font des petits, se multiplient à volonté. Et l’on s’incline respectueusement devant leur écran pour valider le hold-up permanent de notre argent.
Déjà, nous savions bien que le pognon n’est pas tout à fait réel, mais il est devenu virtuel et il est bien plus agréable d’être du côté des gens rentables, d’avoir un compte, là quelque part, qui vous permet d’offrir à boire, de faire son beurre, de sortir tard. Avec la carte électronique, c’est encore plus pratique de consommer sans trop compter. Dès que tu as la connexion, tu dépenses avec pour toute limitation, ton p’tit plafond. Pour peu que tu aies tout prévu, dans l’beurre tu poses ton cul.
Mais pour ceux-là qui dorment dans la rue, y’a pas d’mystère, c’est la misère. Vu que même ceux qui en ont, n’ont plus le moindre sou tout rond, ces pièces que l’on jette négligemment dans l’escarcelle du miséreux. Il peut aller crever ailleurs que dans ce monde meilleur. Gloire à la carte de crédit qui nous rend la vie propre et jolie.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 33 — 01/06/2022
Il faut rester prudent. On le sait. Le Grand Méchant Loup circule toujours à bord d’un RAM 3500 Laramie, moteur turbodiesel. Une bête ! Et si la vitesse en ville est limitée, le Petit Chaperon Rouge a intérêt à se méfier des pulsions refoulées. Un coup d’accélérateur est encore possible. Il arrive que le fauve se déchaîne, oubliant à l’instant toute sa bonne conduite.
Il gronde depuis quelque temps devant le feu rouge. La petite fille passe, fière d’avoir autant de galette que sa grand-mère. Elle n’a plus dans son panier qu’une carte de crédit et jette seulement aux mendiants échoués sur les trottoirs, un regard de mépris.
Derrière le pare-brise d’un noir profond comme la nuit, le loup la guette. Il en ferait bien une bouchée, comme dans le bon vieux temps. Mais la fillette connait ses droits. Elle se campe au milieu du carrefour et brandit son écriteau, avec un brin d’insolence.
Le feu passe au vert. Le loup aussi. Les bolides roulent au pas. Le loup suit, le loup passe, la queue entre les pattes. Il sait bien qu’à la moindre incartade, tous les téléphones cellulaires du pays hurleront son nom, prénom et pédigrée. Il tient à sa peau et s’en va manger plus loin, dans un restaurant végan.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 32 — 31/05/2022
Débarrassée du flot des voitures, la rue Saint-Denis appartenait désormais aux piétons. Ils envahirent l’espace libéré pour venir fêter la bande dessinée. Il ne manquait pas une case et l’on pouvait naviguer sans craindre le naufrage, dans le courant confus des badauds réjouis. C’était un dimanche et il faisait beau.
Je pris donc mon bain de foule, remontant vers l’amont, cherchant la source, plongeant en apnée, reprenant mon souffle près de ces poissons multicolores voraces de dédicaces.
Je croisai quelques sirènes tatouées sur des bras marins. Je m’échouai parfois devant une belle image pour replonger ensuite dans le joyeux torrent qui m’entraina plus loin, vers d’autres continents imaginaires. Je fis l’anguille et des bonds de saumon pour mieux voir quelques baleines qui passèrent en chantant. Il y eut même des poissons volants, des poulpes philosophes, des oursins mal léchés.
Puis je me fis pêcheur pour bien manier ma barque. Je godillai dès lors dans le courant, jetant l’ancre et mon filet pour prendre des images. Il fallait faire vite : elles filaient comme des bancs de poissons iridescents dans toutes les directions.
Lorsque je revins au port, la nasse bien pleine, je jetai sur le quai mes plus belles captures. Je les triai pour rejeter les plus jeunes, encore imprécises. J’aime libérer ces images immatures qui s’en iront ailleurs en créer de nouvelles.
J’eus alors l’évidence de ce joli cliché : un petit trésor que m’offrirent ces deux-là qui s’étaient bécotés, heureux comme des poissons dans l’eau. Je ne les avais pas vus au moment de la pêche. Ils me surprirent là, au centre de mon objectif.
La belle prise de vue révèle l’amour que l’on pèche parfois dans la rue Saint-Denis.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 31 — 30/05/2022
Tu te promènes innocemment, si tant est qu’tes pas soient innocents, rien ne te l’annonce vraiment, tu es au cœur d’une parenthèse et tu te perds, bien à l’aise. Déboule soudain en un frisson, la révélation.
En t’asseyant sur la terrasse de ce petit café qui se réchauffe sous un premier rayon de soleil, tournant un peu autour du pot, tu reçois en plein visage, ce message : « N’oublie pas de t’aimer ! »
Quelle affaire ! Tu le sais bien : c’est du slogan, du bizness, du marketing qui s’colle à la détresse. On te fait l’coup de la tendresse pour t’ponctionner quelques dollars. Ne crois pas à une autre histoire. Mais c’est plus fort que ton café : tu dégustes l’injonction à la petite cuillère. Tu en savoures l’amertume et tu ne penses même pas à l’édulcorer. Tu navigues et divagues avec le vague à l’âme sur l’onctueuse mousse de lait qui rappelle très vaguement les douceurs qui te berçaient, enfant. Près de la mère, tu n’as plus pied. Et le breuvage est bien amer. Tu vas boire la tasse d’un seul coup en te questionnant si tu l’aimes vraiment, ce goût.
Mais ton cœur bat un peu plus vite. Tu te réveilles. Tu te relèves, ragaillardi.
Tu vas poursuivre la promenade, sentir bouger avec jubilation, tes jambes, tes pieds et tes mollets. Tu vas goûter l’air sur ta peau, l’odeur des rues après la pluie, le parfum frais d’une dame peu frileuse. Tes oreilles captent de nouveaux accents, l’éclat d’un rire, un cri d’enfant. Et tes yeux mangent toutes ces images qui défilent infiniment. Tu n’as pas le temps de fixer toute cette générosité.
Tu es debout. Tu vis. Tu marches. Tu as une faim joyeuse que rien ne peut rassasier. Tu es ce corps qui se sourit et qui se remercie d’être en vie en pensant l’instant.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 30 — 29/05/2022
Si je n’écris pas aujourd’hui, demain il sera déjà trop tard. Et c’est ma façon d’être en vie, de remonter ce grand boulevard, le cœur battant en m’extasiant tant qu’il est temps des histoires à peine aperçues de tous ces inconnus.
Et puis, et puis, comme le disait mon bon Queneau, si la vie des autres m’intéresse, si je l’observe avec délicatesse, la mienne aussi je vous l’assure ! Je vous en parlerais bien en ce fatal instant de ma ptite vie. Ça m’intéresse un tant soit peu z-également ma ptite vie. La vôtre aussi et puis celles de mes chéries qui sont là-bas si loin de moi.
En ce jour d’anniversaire de mon débarquement sur cette étrange terre, j’ai bien envie de lever le rideau, que l’on allume tous les projos, qu’on fasse la fête jusque dans les coulisses en invitant les hommes et les femmes fantômes laissés pour compte dans les impasses de cette ville où s’effacent leurs traces.
Mais je resterai discret. Avec lenteur et minutie, je ferai ce que je pourrai pour dissoudre un peu de misère sans en avoir l’air. Je remonterai sur les planches un autre dimanche où je serai à nouveau camelot-poète, présentant dans un fou rire et en musique, mes jolis produits Pot-Éthiques. Je garde dans une immense bouteille des mots très doux qui émerveillent et qui éveillent. Amis, nous ferons péter le bouchon quand nous nous retrouverons.
Une lecture du texte est à écouter ici : https://youtu.be/m6SyT4-jFaQ

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 29 — 28/05/2022
Et puis il y a ces croisements de nos chemins de vie. On a beaucoup marché, traversé la ville et le temps. On se surprend avec tous ces récits que l’on a accumulés. On ne s’attendait pas à se raconter aussi spontanément. Mais on partage ce soir, parce qu’il fait doux, que l’on se sent bien ensemble avec une évidence miraculeuse.
Au début, on se provoque un peu du coin de l’œil, on tâte le terrain en accordant notre langage, ce français qui lui aussi a bien voyagé, qui vit en nous et qui palpite. Il a pris racine ici, il a des saveurs de notre ailleurs, il est épicé par cette langue qui impose son pouvoir de commerçant mondialiste. On cherche les homonymes qui préservent notre humanité en se méfiant de ceux qui nous isolent dans une identité.
On les aime tous ces mots. On en extrait la moelle rabelaisienne. On en goûte les doubles sens. On savoure la métaphore. On glisse vers la métonymie, voire l’hypallage. Mais on évite avec humour les pires calembours. Quoiqu’en fin de repas, nos frontières sont abolies. Nous échangeons avec tendresse nos histoires de vie. On a joué cartes sur table.
Alors, on reprend son souffle et ses bagages. On sait déjà que l’on se reverra puisque l’art de la conversation partagé ce soir nous a permis de déguster nos affinités et de fêter notre ancienne ou toute nouvelle amitié.
A Anne, Patrice et Marie

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 28 — 27/05/2022
Marcher encore puisque j’ai l’immense privilège, l’étrange folie et sans doute un peu de courage ou de naïveté pour oser faire de ma vie une sorte de promenade. Marcher en se laissant surprendre par les frontières que l’on traverse, comme on le fait en écrivant.
Tu crois connaître l’itinéraire, tu l’as tracé, tu cernes les lieux, à peu près les personnages, mais soudain tout ce que tu as prévu se métamorphose, prend son autonomie et s’emballe pour te conduire ailleurs. Terra Incognita. Tu replies ta carte et acceptes la déroute.
Tu n’es plus que le réceptacle d’une aventure intérieure qui t’entraine à découvrir l’envers du décor et tes coulisses intimes.
Tu te rends compte que les piliers qui soutiennent ton édifice sont bien fragiles. Le béton se dégrade, les ferrures apparaissent, la rouille et le temps ont tout grignoté. Tu n’es plus armé.
Mais par la fissure qui grandit entre tes certitudes, tu es ébloui par la splendeur lumineuse. Tu es conscient du réel qui n’a rien de confortable. Tu vis.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 27 — 26/05/2022
La truite des Bobines a remonté le courant pour venir faire frétiller mes papilles, façon gravlax, sur ce lit de laitue frisée émoustillée par les échalotes au vinaigre et magnifiée par la rouille d’oursin. Cela commençait bien.
Vint ensuite et sans se presser, l’adorable et rond pétoncle poêlé qui s’offrit pudiquement sur sa couche de pleurotes Blanc de Gris marinés, baigné par cet exquis consommé infusé au sarrasin. Après la délicate dégustation, par petites bouchées, des textures moelleuses où le croustillant de la tuile contrastait heureusement, j’admirai la salle, vérifiai que nul ne m’observait et, avouons-le, je sauçai.
Reprenant mes esprits, m’accrochant à un reste d’élégance, j’accueillis ensuite avec un sourire de plus en plus large, le canaille cotechino maison poêlé, une tranche de saucisse gaillarde qui se dandinait plus grassement dans ses lentilles béluga aux choux de Bruxelles fermentés jusqu’à ce que le pickle de moutarde tempère sa rusticité.
Je respirai avec reconnaissance, l’âme sereine, l’œil ému, puis accueillis la gracieuse caille rôtie sur le coffre, cuisse en cromesquis, venue se pâmer autant que je le fis, sur sa purée fine de céleri-boule.
Le temps s’immobilisa. Mon verre de vin rouge, une surprise venue du Jura et m’apportant ses fragrances de fruits rouges et noirs en un joyeux Trousseau, pleura mes larmes de joie.
Enfin, ce fut un bouquet final de saveurs très anciennes, de celles qui évoquent les groseilles rouges chapardées dans les buissons de notre enfance, contenues dans la charmante tartelette au yaourt de bufflonne, recélant le secret d’un praliné aux graines de tournesol et chapeautée d’une gelée de cassis ornementée de fleurs du moment.
Ainsi se conclut cet instant de beauté.
Car c’est bien cela, la grâce de l’instant : ce moment où les choses se touchent, s’assemblent, s’harmonisent. Il y eut la passion d’un chef et de sa brigade, celle des sommeliers qui magnifièrent la dégustation de chaque plat par des vins vivants, orange parfois, toujours très particuliers, et ma disponibilité totale. Il y eut aussi le langage du maître d’hôtel philosophe, qui en amoureux des mots intensifiait encore le plaisir transmis par les mets.
Cela se passait un soir au restaurant de l’Institut du Tourisme et de l’Hôtellerie du Québec. Tout bonheur est fugace, mais il faut cultiver l’art de le goûter.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 26 — 25/05/2022
L’aboiement très reconnaissable vient d’en haut. Je lève les yeux. Derrière l’une de ces fenêtres toutes semblables, l’aventure est en cours. Je connais l’histoire. Je la lisais déjà tout gamin. J’ai toujours l’album en plusieurs versions, noir et blanc ou en couleurs. J’ai dû le parcourir des milliers de fois pour vérifier son éternité narrative et rechercher les traces de mes émerveillements d’enfance.
Il faut sauter de case en case pour parvenir à suivre Milou qui n’en fait qu’à sa tête et perturbe la linéarité morale de Tintin.
Et voilà qu’il apparait soudain, mon héros du normal, mon zéro graphique, passant audacieusement par le battant d’une fenêtre, posant le pied sur l’appui de la suivante, franchissant le vide, s’agrippant au dormant du cadre et plongeant enfin par-dessus l’allège tandis que le châssis coulissant se referme. Pour sauver son chien capturé par un gang, il a risqué la guillotine. Je respire. Milou jappe. Tintin le sermonne.
Je compte les fenêtres qui sont les cases bien régulières d’une vieille bande dessinée. Tintin m’accompagne en Amérique.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 25 — 24/05/2022
On ne vous apportera pas tout sur un plateau, pardon : un cabaret*. Dans le spectacle permanent de la vie, il faut savoir jongler et souvent contourner l’obstacle, trouver un nouveau chemin en évitant la catastrophe d’un conflit stérile. Au diable, la performance !
On ne peut traverser l’existence en ligne droite même si l’on a acquis un certain équilibre.
Le promeneur-philosophe a l’art du détour, du chemin sinueux, de l’itinéraire aléatoire et même de l’impasse qui lui apporte toujours quelque chose. Dans une voie sans issue, il lui est encore possible de faire demi-tour en ayant conscience que l’on ne revient jamais sur ses pas. Rebrousser chemin, c’est déjà changer de point de vue.
De toute façon, ce qui importe, c’est la promenade, qu’elle soit courte ou longue, et les beaux instants de gourmandises partagés.
Mais ce soir, je passerai mon chemin, préférant déguster à la petite cuillère ma solitude et ses saveurs complexes, toujours douces et amères.
Le serveur n’est guère avenant et je ne risquerai pas l’accident.
* On désigne ainsi à Montréal le plateau utilisé dans un restaurant en libre-service.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 24 — 23/05/2022
Au début, elles vous paraissent charmantes, ces petites bêtes. Vous traversez un jardin public, vous longez ce joli potager communautaire et vous êtes surpris par l’écureuil qui jaillit du buisson, s’immobilise, vous observe, cligne de l’œil, hausse les épaules et poursuit son chemin sans plus s’occuper de vous. Un peu méprisant, l’animal. Après tout, vous êtes une plus grosse bête que lui.
Vous continuez votre promenade. Vous en rencontrez un autre qui a chapardé quelque chose et qui le tient comme un avare le ferait de son trésor. Vous savourez vos clichés anthropomorphiques en ricanant avec Tex Avery.
L’après-midi s’écoule. Vous en observez bien d’autres, toujours affairés. Mais vous avez la désagréable impression qu’ils vous tiennent à l’œil.
Vous ressentez une légère inquiétude lorsqu’ils se rejoignent. Deux, trois. En voilà encore un autre qui bondit et caracole. Ils sont au moins six, accrochés au tronc de cet arbre. Ils pullulent.
Vous les trouvez de moins en moins charmants, gris et sales, bien canailles. Ils n’ont pas la grâce flamboyante de leur cousin roux dont vous avez toujours apprécié la fugacité et surtout l’unicité. Et puis franchement, ne serait-ce un reste de panache du côté de la queue, n’ont-ils pas plus de ressemblance avec le rat, surtout par le nombre ? Vous pestez en proie à de vieilles terreurs.
Le soleil décline. Les ombres mauves s’allongent. Voici l’heure crépusculaire où se révèle le mystère. Vous remarquez les bandes qui se forment. Ici, ils sont déjà plus d’une dizaine. Vous pressez le pas. Ils couinent autour de vous.
Vous avez l’impression qu’ils vous suivent et même que certains vous précèdent. Il n’y a plus d’autres promeneurs. Les rues sont désertes. Chacun se barricade. Un chien, quelque part, hurle brièvement. Vous êtes l’étranger dans la ville qui se métamorphose. À vos pieds, un flot gris vous entraîne déjà.
Vous avez juste le temps de comprendre pourquoi il est conseillé de faire pousser devant sa demeure des plans de ruda, l’herbe de grâce. Trop tard.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 23 — 22/05/2022
C’est l’engrenage : tu retournes au papier. Ce n’est pas tout de lancer des mots sur la toile, encore faut-il les semer dans un terreau où ils feront des petits pour que le lecteur moissonne. Nous reviendrons donc au pamphlet et à nos impressions de pirates en pensant au lithographe Carlos et à ses pierres brisées.
Il nous a raconté sa vie qu’il a créée en artiste, passant de l’Angola à la Révolution des Œillets pour atterrir à Montréal afin que l’existence soit en taille-douce. L’encre bien noire est source de résistance. La lithographie multiplie les éclairs de conscience. Et la beauté du monde se révèle soudain dans la trame méticuleusement gravée. Elle a les traits de la femme perdue. Saudade. Ce n’est pas tant l’accumulation de nos images qui importe, nous ne possédons rien, mais le chemin expérimental de leur création.
Revenons aussi au caractère de plomb. Que notre langage s’incarne, prenne du poids ! Nous ne traiterons pas le texte pour le réduire en esclavage. Il ira là où on ne l’attendait pas.
Il faut libérer aussi et le plus souvent sauver, quelques précieuses machines dont on méprise l’ingénieuse histoire et surtout celle des artisans qui les firent ronronner. Retrouvons le chant de l’encre sous son rouleau amoureux. Presses typographiques, offset, pour l’estampe, à platine, elles sont là, bien campées, trapues sur leurs pattes de fonte, solides, têtues et étonnées d’être encore utiles à quelque chose.
Mais Carlos nous l’a rappelé : dans l’étouffoir d’une dictature, les typographes imprimeront toujours des cris de liberté et les sérigraphes feront hurler les murs.
Il nous faut toutes les couleurs des encres pour que la vie perdure.
(Merci à l'Atelier Circulaire et à mon guide, Francine Metthé)

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 22 — 21/05/2022
Ils sont sur la mauvaise pente, mais nous on s’accroche ! Nous vivons, nous mourrons, nous nous enchevêtrons et poursuivons nos cycles. Ils pourraient en prendre de la graine, mais ils sont sourds à nos murmures. Chacun son langage. Ils ignorent depuis toujours le nôtre, se gargarisant de leur parole et insensibles à tout ce qui diffère de leur normalité. D’ailleurs ils sont implacables même pour ceux qui faisant partie de leur espèce, s’écartent de leurs codes si mouvants. Ils exterminent les amis d’hier en les isolant dans une identité meurtrière. Leur cruauté est infinie quand il s’agit d’éradiquer une différence le plus souvent fantasmée.
Ils en sont venus à museler même tout ce qui les fit jadis survivre, contraignant leur imagination qui est pourtant sans limite. Par réflexes sécuritaires et normalisateurs, ils enferment leurs petits dans des prisons scolaires. Les enfants ne nous grimpent plus dans les branches. Nous eûmes cependant de belles complicités et il est plus d’un jeune poète qui eut la révélation de son art de vivre en captant le frémissement de notre frondaison ou les alliances sensibles qui naissent dans l’enchevêtrement de nos racines.
Mais ils passent désormais. Certains se préoccupent de laisser notre nature reprendre ses droits. Ils ferment des sentiers inutiles qui nous déchirent l’âme. Ils tentent de nous laisser de la place. Ils n’ont pas encore compris la dérision du pouvoir qu’ils exercent encore. Ils veulent toujours atteindre le sommet du Mont-Royal pour dominer la plaine. Certains le font même au pas de course, s’enivrant de performance. L’essentiel leur échappe. Il palpite pourtant dans les enchevêtrements tortueux que nous inventons patiemment. Il suffit de nous contempler un instant pour le percevoir.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 21 — 20/05/2022
J’en étais arrivé au croisement de la rue Faillon et de la rue Berri, espérant l’accueil du Cafécoquetel qui, étant fermé, ne m’offrit que la perturbation de mes perspectives. Ce n’était déjà pas mal et je tentais de me sentir d’aplomb lorsque je le vis marcher de l’autre côté du miroir. Ce type-là me rappelait quelque chose. J’étais certain de l’avoir croisé ailleurs. Il s’approcha calmement. Il paraissait aussi peu pressé que moi.
Arrivé à ma hauteur que je cherchais encore à déterminer, il n’hésita pas à m’adresser la parole : « Tu vas bien ? ».
C’était une bonne question. Je venais justement de me la poser. Je répondis donc presque sans barguigner que j’y réfléchissais, pesant le pour et le contre, faisant le bilan et que j’étais plutôt paisible en n’attendant rien, mais recevant ce qui advenait comme un cadeau de la vie. Je le perçus un peu impatient devant mes circonvolutions.
Je lui avouai alors avec plus de précision qu’en cet instant, j’avais rendez-vous avec une chargée de mission culturelle dont le titre me paraissait déjà aventureux.
Il me sourit et s’assit à côté de moi en me donnant un affectueux coup de coude. Je le trouvai bien familier.
- Tu ne changes pas ! Tu ne peux t’empêcher de faire des histoires !
Cela me fit rire. Il semblait bien me connaître.
Je l’observai plus attentivement. Casquette, marinière sous la veste légère, foulard en harmonie. J’avais moi aussi choisi d’assortir les mêmes vêtements. Et il portait en bandoulière la réplique exacte de ma jolie besace en cuir. L’œil pétillant, il paraissait à la fois perplexe et amusé par notre confrontation.
J’eus un bref éblouissement. Le taxi conduisant la dame avec laquelle j’avais rendez-vous s’arrêta à l’angle des deux rues. La portière en s’ouvrant projeta un éclat de lumière qui balaya les reflets mouvants dans lesquels je me cherchais. Ayant retrouvé mes esprits à défaut d’autre chose, je déclarai joyeusement à ma nouvelle interlocutrice qu’un voyage est toujours une rencontre avec soi-même. Un curieux reflet passa dans son regard.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 20 — 19/05/2022
Touriste, regarde-moi dans les yeux. Tu n’as pas fait tout ce chemin, traversé des frontières, souri aux douaniers, réservé un hôtel, gravi en transpirant les marches des escaliers qui serpentent sur le flanc du Mont-Royal, pour rater notre rencontre ! Reprends ton souffle, tes esprits, and look at me. J’ai des choses à te dire entre quat’z’yeux et bien d’autres à te montrer.
Approche, n’aie pas peur et lâche ton smartphone par lequel tu appréhendes le monde. Libère ton regard ! Il est temps pour toi de voir autre chose, d’ouvrir l’œil et ta pensée unique. J’ai du vécu, des histoires engrangées à te raconter. Depuis le temps que je suis planté ici, j’en ai vu défiler des amours, des humains, des mutations urbaines, des courses de nuages, des avions, des oiseaux, des saisons, des nuits et des jours, des vies et des morts.
Viens ! Jette un coup d’œil pour voir plus loin et multiplier tes points de vue. Je vais te dessiller la pensée, t’ouvrir de nouveaux horizons et de belles perspectives. Je t’offre à l’instant un nouveau regard sur la vie. C’est une mise au point. Ne prends pas la fuite !

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 19 — 18/05/2022
Suspendre quelques jours de ma vie tout là-haut, dans cette tour sombre de béton qui domine la plaine d’où aucun ennemi ne viendra puisqu’il n’existe pas. Pourtant certains de mes voisins âgés semblent se méfier, se retranchant frileusement derrière leur porte verrouillée électroniquement, à peine rassurés par le gardien en uniforme enfermé dans sa guérite au rez-de-chaussée. Il sacrifie son existence à une fonction débranchée du réel. Tout est si calme dans les ruelles.
Mais où est-elle donc, la réalité ?
Peut-être dans cette promenade passagère qui me fait découvrir des lieux et des êtres inconnus et dans cette construction chimérique de sable, de gravier, de ciment et d’eau que le temps peu à peu dissout autant que mon orgueil. Les blockhaus dans lesquels nous voulons tant nous exiler redeviennent déjà poussière. Nos paroles et nos rêves sont balayés par ce vent qui ébranle ce matin les ferrures du balcon et qui vient chanter la dérision de toute chose.
Seuls importent les prochains pas que je ferai vers toi et ton sourire mélancolique quand tu goûteras mes mots.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 18 — 17/05/2022
Quoi, ma gueule ? Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ? Pourquoi me regardes-tu ainsi ? Tu veux ma photo ? Ou pire, celle de ma maîtresse ? Bâtard, va ! Faudrait pas pousser trop loin ton goût pour l’image narrative ! T’es prévenu : je suis d’une humeur de chien.
Je dois patienter pendant que madame envoie des textos à son nouveau chum et il va falloir rester assis et attendre cet abruti ici, alors que j’ai déjà envie de l’envoyer promener. Parce que je connais la chanson. Au printemps, les humains sont des bêtes. Les phéromones tourbillonnent tous azimuts. Tu peux me croire, j’ai du flair.
Et dans quelques semaines ou quelques mois, ce sera comme à chaque fois la chute libre dans le chagrin d’amour. Et qui sera là pour éponger les pleurs, lécher les blessures ? C’est bibi, toujours bibi, le seul qui reste fidèle au poste.
Mais je ne me plains pas : croquettes de premier choix, promenades régulières, la baballe de temps en temps, des caresses quotidiennes. Je ne te dis pas l’effet de ses doigts agiles aux ongles carminés dans mon pelage électrisé ! Et puis, je suis bien le seul qu’elle garde en laisse quand je la promène. Ce n’est pas une preuve d’attachement, ça ? Elle n’a même pas essayé avec les autres. Je suis pourtant certain que quelques-uns auraient aimé. Mais il n’y a qu’avec moi qu’elle ose être maîtresse. Je suis son chien. Je l’ai dans la peau.
Si tu t’approches, je mords !

Chronique d'un voyage poétique à Montréal 17 — 16/05/2022
Ne prends-tu pas un mauvais tournant en choisissant d’explorer cette impasse ? Tu le sais pourtant, que la vie ne tient qu’à un fil. Et cette conscience t’oblige à toujours chercher l’équilibre. Tu fais à nouveau le point : ne serait-ce pas le moment de laver tout ton linge sale en famille ? La grande lessive en quelque sorte. Le nettoyage de printemps. Passer un savon à toutes les vieilles habitudes au risque d’en sortir lessivé.
Mais il n’y a plus beaucoup de monde au bout du fil. Tes morts sont aux abonnés absents. Draps et liquettes suspendus évoquent tes fantômes bien et mal aimés. Tu les salues affectueusement. Ils s’en balancent et restent là, sagement accrochés à tes paroles. Tu penses à François Villon et à tous ces frères humains qui finirent pendus. Puis tu te pinces pour revenir au linge.
Il fait beau. Tu es vivant. Il est temps de suspendre tes pensées les plus sombres et de bien les ranger dans cette part d’ombre que le soleil de mai révèle si bien en toi.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 16 — 15/05/2022
La Dodge Challenger est un fauve immobile qui ronronne au bord du trottoir. Vous ne la verrez plus bondir. La vitesse en ville est désormais limitée à 40 km/h. Moins encore dans certaines rues de Montréal. Le monstre ronge son frein.
Son propriétaire, amoureux transi, a tenu à rappeler la possibilité de sa puissance. Il lui a offert une plaque d’immatriculation personnalisée. C’est la moindre des choses pour une muscle car, moteur V8 de 6,2 litres suralimentés, développant 840 chevaux, boîte automatique à huit rapports. Elle est toujours prête à faire son cinéma.
Quand son maître s’y assoit et qu’il s’engage dans la circulation calme, la musique de Lalo Schiffrin emplit l’habitacle. L’image se fractionne. L’épisode commence.
Moteur ! Mike Connors traverse au pas de course le passage pour piétons. Il s’approche, l’arme au point. L’heure est grave. Il va falloir poursuivre. Il ouvre la portière, s’effondre sur le siège passager, les sourcils tourmentés par l’angoisse. Peggy Fair interprétée par l’éternelle Gail Fisher, une des premières actrices afro-américaines à avoir joué aussi régulièrement dans une série, est prise en otage.
- Démarre, hurle Joe, il faut poursuivre la narration.
Dans un hurlement, les pneus s’arrachent à l’asphalte. La voiture bondit, brûle les feux rouges, se faufile de justesse devant un camion claironnant son indignation, prend à contresens une ruelle qui serpente, s’envole quelques instants par-dessus les dos d’âne, retombe dans les étincelles de ses pare-chocs maltraités, un enjoliveur chromé redescend seul la ruelle.
La Dodge s’est arrêtée trois cents mètres plus loin, à un nouveau feu rouge. Passent les piétons. Joe Mannix s’extirpe péniblement du véhicule. Il soutient ses vieux reins. Il est franchement amorti.
Nous ne sommes plus dans les années 70. Et même si l’essence coûte deux fois moins cher qu’en Europe, nous ne sauverons personne.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 15 — 14/05/2022
On décrète l’exceptionnelle canicule. On s’étonne du record. On consulte les statistiques. Mais on ne s’inquiète pas vraiment de la mutation. Sortant du froid, on en profite un peu puis on recherche l’ombre.
Déjà des dames opulentes se déshabillent tandis que le jeune homme abondamment musclé exhibe les pectoraux de son torse nu. En équilibre sur son skate, il fend la foule des badauds ramollis où certains n’ont pas encore osé tomber la veste. Des tricots incongrus perdurent au risque de la congestion. Le bitume fume et fond. La vapeur s’élève. L’air vibre. Le vent très lourd apporte la poussière du désert. On abrite les regards fiévreux sous des lunettes noires. On titube, mais on s’accroche.
Voilà que le parfum du cannabis flotte sur la ville. On hallucine au milieu des tentes berbères, la danse vient du ventre, la caravane passe sans qu’aboient les chiens à la langue pendante.
Proche de la déshydratation, on échoue juste à temps sur la terrasse en bois d’une brasserie artisanale. Le personnel soignant du Dispensaire de la Bière dont l’enseigne évoque le serpent d’hypocrite, vient à votre secours. À bout de force, vous choisissez la chopine de Jean-Loup, une IPA du Nord-Est, amertume tranchante, fortement houblonnée, aux saveurs d’agrumes, pamplemousse, lime, citron, orange, complétées par un arrière-goût résineux. Vous avez découvert l’oasis salvatrice et vous contemplez la lumineuse transparence de ce trésor en cherchant les mots pour intensifier le plaisir ressenti.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 14 — 13/05/2022
Entre amies, elles picorent en catimini les petits sushis et prennent la vie avec des baguettes. Car enfin, on le sait bien, le monde n’est pas si beau. Il est même brutal. Et la réalité ne devient supportable qu’en inventant la sienne. C’est leur dessein. Et ce n’est pas pour rien qu’elles couvrent peu à peu leur corps de dessins. Elles créent et portent leur histoire à fleur de peau : poupée d’enfance aux grands yeux d’innocence, volutes graciles, fleurs épanouies et griffes meurtrières. Elles se promènent dans la ville en bande dessinée et restent sages comme des images.
Toi qui aimes l’arabesque, la courbe gracieuse et le trait volubile, tu te demandes quand même jusqu’où serpentent certains tatouages. Voilà ton imaginaire piégé par le hors-champ. Tu aimerais admirer les chemins sinueux. Mais lorsque tu as l’audace de demander la permission de l’image, elles acceptent la pause, raides et charmantes. Tu n'emporteras avec toi que le mystère des icônes.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 13 — 12/05/2022
Tu ne t’en rends pas toujours compte, mais les choses se passent là, à tes pieds. Il suffit de s’arrêter un instant et de baisser les yeux vers ce lopin de terre préservé et semé d’amour. Un improbable jardinier a bêché, scarifié, ratissé et enrichi une terre moribonde pour faire jaillir en un printemps attendu, le désordre de la vie. Et voilà que d’un coup, aux premiers rayons de soleil, cela s’élance, grouille, se multiplie, s’emmêle dans une abondance presque illisible à force de générosité. On n’éclaircira rien. Pas de castration en ce lieu. On laisse aller le chaos vital. Plantes acaules frôlant le limbe, pétiole attendri cherchant la gaine, pédoncule caressant ses pédicelles, folioles titillant l’involucre, spathe désirant la corolle, bulbes bouleversant le terreau parcouru de radicelles, pistil émoustillé par le bourgeon. Cela ploie, plie, palpite en lents frémissements sous la bise légère qui t’offre des fragrances nouvelles.
Ragaillardi, tu poursuis ton travail de promeneur à plein temps.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 12 — 11/05/2022
Le tout petit monsieur a une bien grande responsabilité. Il veille au détournement des mauvaises intentions. Il y en a toujours qui veulent forcer le passage. Vous connaissez les gens. À force de marcher droit, ils ont peur de prendre un mauvais tournant. Alors, vous pensez ! Leur faire changer d’itinéraire, c’est un dérapage insupportable dans leurs habitudes. Parfois, certains se conduisent mal.
Avec sa petite taille qui le fait ressembler à un Playmobil de dos, il barre la route de toute sa personne. Ce n’est pas grand-chose mais cela suffit. L’autorité n’est pas une question de taille mais d’attitude. Il l’a bien compris. Lorsqu’il se retourne lentement, une musique de western envahit la rue, l’air s’immobilise, les passants aussi. Il jauge. Il juge. Son regard implacable flamboie à l’ombre de son casque.
Et puis il déplace en souriant les bornes de plastique pour permettre le passage à la voiture d’une maman locale, tout encombrée d’enfants. Avec fierté, il bombe le torse. Il grandit à vue d’œil illuminé par la gloire d’un héros du quotidien.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 11 — 10/05/2022
La brunante s’épaississant, elle enveloppa la ville, imposant un relatif silence, calmant tous les jeux. Chacun rentrait chez soi sauf ceux qui n’en ont pas et qui cherchaient l’encoignure pour s’y claquemurer dans l’inexistence. Mais tous les autres devaient digérer leur dimanche et se préparer pour une nouvelle semaine où il leur faudrait jouer leur rôle, monter sur les planches, participer au spectacle.
Et moi qui ai tant de goût pour les coulisses, je quittai le théâtre des belles avenues pour fouiller du regard les venelles obscures. Je cherchais un terrain pour y semer mon vague à l’âme. C’est une pratique de maraîchage poétique qui renforce ma permaculture personnelle et fait croître mes pensées sauvages. Je ratissais large.
Et voilà que là, tout à coup, dans un dernier éclat de lumière, entre la grisaille des murs graffités et le bitume crevé de la ruelle, jaillit une source de beauté qui bouleversa mes perspectives et changea instantanément mon point de vue.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 10 — 09/05/2022
Au printemps, l’oiseau migrateur se pose sur un balcon bien situé dans une rue passante, en plein soleil, et visible de loin. Il se met rapidement à roucouler des mots d’amour en s’accompagnant d’une guitare éclectique, passant d’une ballade folk à un riff punk ou aux longues lamentations d’un rock psychédélique. Il improvise. Il brasse large.
Au bout de quelques minutes, des femelles de tous les âges ou d’autres espèces moins genrées lèvent le col vers le maître chanteur qui n’en gratte que de plus belle l’instrument qui le démange. Gonflant la poitrine, il hausse encore le ton.
Bientôt, c’est une petite basse-cour frétillante qui se crée et se meut à ses pieds. Il sourit. Il est aux anges. Cela valait le voyage.
Il ne lui reste plus qu’à choisir une partenaire pour la faire grimper à l’échelle en espérant qu’il n’y ait pas de fausse note.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 9 — 08/05/2022
Elle cultive ses paradoxes dans une vitrine glamour de Montréal. Elle ne s’en plaint pas. Elle a tout fait pour y être en proclamant sa différence. Elle en est devenue une référence. On la nomme. On l’expose. On la montre en exemple. On se déculpabilise d’une envie de rejet en l’invitant à la moindre mondanité. Elle joue le jeu et caresse les prédateurs dans le sens du poil. Elle scintille. Elle sourit.
Sous les paillettes, au-delà des reflets, elle frissonne au bord de l’abîme de solitude qui s’ouvre toujours sous ses pieds lorsqu’elle déambule dans le quotidien et que le regard des autres se pose sur son grand corps. Cessera-t-on un jour de l’isoler dans cette seule identité qu’elle a tant voulu imposer ?

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 8 — 07/05/2022
À mon sujet, ils pensent avoir tranché dans le vif. Mon œil ! Ils méconnaissent la puissance radiculaire. J’ai résisté en douce, traversé l’hiver en faisant le mort. Je suis du bois dont on fait les héros modestes et discrets. Dès ce joli printemps, j’ai retrouvé la joie d’être toujours vert.
Avec la lenteur opiniâtre qui caractérise ceux de mon espèce, j’ai lancé de nouvelles pousses, bourgeonné en douce et développé mon réseau de radicelles qui me permet de capter les frémissements d’empathie de quelques frères dont le tronc fut moins martyrisé que le mien. J’avoue que cela m’a soutenu après cet instant incompréhensible où je fus privé de ramure. Cela reste une émotion vague et brutale, un instant de basculement tragique dans ma paisible existence. J’ai ressenti longtemps l’absence de la vibration de mon feuillage.
Les hommes, bien sûr, n’ont plus fait attention à moi, traçant des routes, bâtissant d’autres tours, bétonnant la moindre parcelle de terre encore en friche. Ils sont bien actifs, les bougres. Sans doute est-ce la peur née de leur conscience de n’avoir qu’une vie fort brève, qui les pousse au mouvement permanent et à vouloir occuper tout le terrain. Beaucoup sont morts en effet, tandis que je patientais. J’ai gardé mon rythme, ma pulsion lente, mes bruissements imperceptibles. J’ai goûté les saisons, le sommeil de l’hiver, l’éveil du printemps.
Tandis que mes racines crèvent peu à peu le bitume du trottoir qui m’emprisonne, je perçois toutes les failles de leur système, l’effondrement qui approche, l’équilibre que la vie cherche à rétablir.
Je serai toujours là lorsqu’ils n’y seront plus.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 7 — 06/05/2022
Quittant le beau marché Jean-Talon (Qui lait cru, j’ai trouvé de bien beaux fromages !), je redescendais paisiblement la rue Saint-Denis ayant choisi de rentrer à pied pour profiter du frémissement printanier. J’observais du coin de l’œil, les bourgeons érectiles d’arbres pâmés sous la caresse très tendre du soleil, lorsque les ferrures ouvragées des balcons grincèrent leur plaisir. La chaleur nouvelle leur dilatait l’âme. Elles s’en tordaient de bien-être et serpentaient imperceptiblement dans des éclaboussures de lumière, métamorphosant les marches des escaliers en xylophones.
Moi-même qui ne suis pas de bois et encore moins de fer, je ressentis mon humeur grimper quatre à quatre les degrés de chaque échelle. Hardi ! Le printemps s’installe. La sève monte. Les cœurs palpitent. Le sang pulse. La vie revient.
De graciles bicyclettes cliquetaient de désir, rendues électriques par l’air soudain chargé d’amour. Elles s’accrochaient passionnément à la ferronnerie des balustrades. Tubulures, tuyaux, barres et tringles frémissantes s’enlaçaient désormais sans gêne pour s’aimer et se répandre jusqu’aux trottoirs.
Quoi de plus beau qu’un printemps à Montréal lorsque se libèrent les vélocipèdes.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 6 — 05/05/2022
C’est annoncé : « Mother’s day is coming !”. Voilà que la révolution douce commence à Montréal ! Et personne ne m’a prévenu ! J’arrive à peine. Laissez-moi souffler. Je ressens encore le décalage horaire en plus de celui qui m’est quotidien.
Mais les événements d’exception surgissent toujours ainsi sans qu’on les attende. Ils ne se préoccupent pas de votre capacité à les accepter.
Moi, je n’y croyais plus vraiment même si j’espérais confusément le grand chambardement, la mutation nécessaire, le bouleversement d’une culture patriarcale obsolète.
Et là, tout à coup, en plein centre de la ville que j’arpente, au cœur du quartier des banques et devant l’église désertée, le cube incongru est venu se poser. Il est habité par des êtres étranges, silencieux et graciles qui végètent quelque peu. S’enracinant dans la vie et dans un terreau ancien, ils communiquent un bien être sans avoir recours au langage des hommes. On ne s’y trompe pas pourtant. On s’approche. On se sent bien. Leur bienveillance abolit le béton qui commençait à nous oppresser. Et leur parfum de tendresse nous apaise.
Ils nous le susurrent encore : « Mother’s day is comming ».
Et voilà que les femmes d’affaires, les banquiers, les jeunes et vieux carnassiers, les créatrices de start-up, les serviteurs du Capital, les sacrifiés du business, les guerriers, les guerrières, tous, toutes, déboulent des tours de verre pour courir vers le cube salvateur ! Pleurant de gratitude et surpris par leurs émotions qui, si longtemps refoulées, débondent, ils s’emparent des brassées de fleurs qui se régénèrent à l’instant. Flower Power ! Ils gambadent, sautent et dansent comme les enfants qu’ils n’ont jamais cessé d’être puis se hâtent d’aller les offrir à leur maman.
Le jour est venu ! Plus de haine à la mère. Le monde va aller un peu mieux.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 5 — 04/05/2022
Il faut savoir descendre le boulevard Saint-Laurent, pareil à l’eau qui toujours cherche à rejoindre le fleuve. C’est une question de vie, de partage et de battements de cœur. Car même dans ma solitude et peut-être grâce à elle, je sens au plus profond de moi les palpitations d’âmes, les liens d’amitié et d’amour, les frémissements passagers de tous ces humains inconnus que je croise. Je suis un pêcheur de regards et d’émotions fugaces.
Je me laisse entraîner par le flux, par le flot. Je nage dans la foule, souvent à contre-courant. Et cela me donne soif.
Je cherchais un petit café coquet, le Pista, pour y faire couler mon encre. Une amie m’en a fait l’éloge. J’en reparlerai. Mais il faut que je poursuive le cours de mon récit. C’est que je nage un peu. Je ne suis pas le seul.
Deux jeunes filles remontaient le courant et la rue à la façon obstinée des saumons. Elles étaient sirènes. Je le perçus tout de suite. Car bien qu’habillées semblablement de noir, je distinguai le scintillement mordoré de l’écaille par l’entrebâillement des manteaux gothiques. Accrochées l’une à l’autre, elles ne pouvaient dissimuler leur difficulté à être terre à terre. Elles n’étaient pas dans leur élément et tanguaient un peu en respirant difficilement la poussière urbaine. Elles avaient tant besoin d’eau fraîche que leurs bouches se rejoignirent pour un long, très long baiser qui leur permit enfin de mieux respirer. C’est alchimique, ces choses-là. Comme j’étais rassuré pour elles et qu’un instant de bonheur est contagieux, je laissai s’épanouir mon grand sourire. Elles firent de même et leurs yeux me pétillèrent leur joie. Alors, ouvrant de larges nageoires en guise d’ailes, elles s’élancèrent gracieusement par-dessus le flot des voitures puis au-dessus des toits.
Voyager vous fait découvrir bien des choses. Je savais certains poissons capables d’envol. Les sirènes aussi.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 4 — 03/05/2022
Il faut s’occuper de sa faim et nourrir sa solitude. Ce n’est pas désagréable mais on est un peu perdu. Il s’agit de magasiner à la façon d’ici et comme on reste gourmand, on tente le repérage. On marche. On se méfie des rues trop touristiques. On cherche la boutique de l’honnête artisan. Et bien sûr, on finit par se faire happer par le grand magasin bio et logique. Après quoi, on se retrouve un peu désorienté, dans une rue nouvelle où les images qui courent sur les façades cubiques, transforment le quartier en bande dessinée. Ne nous manquerait-il pas une case ? On s’accroche à un phylactère mais il est psychédélique et dissout la narration linéaire. Il vous entraîne dans une histoire sans début, ni fin. Y aura-t-il un point de chute ?
En attendant, on attrape le récit au vol, on saute dans le chemin de fer, on monte à bord. Les rues en pente douce s’inclinent davantage. Voilà que tanguent les bâtisses. Une dame inconnue, sensible à votre look d’européen, vous interpelle en vous croyant français. On précise naviguer habituellement sur les collines d’un pays plat. Elle rit et s’excuse. Y’a pas d’mal. Et chacun poursuit sa navigation personnelle.
Et puis voilà qu’au coin d’une rue, la légende vous rattrape. On ferme le col de son caban, sous la bise marine qui commence à soulever la poussière des travaux de voirie. On réajuste la casquette. Il faut désormais affronter le kraken, remonté des égouts éventrés et des abysses de vos lectures anciennes. C’est délicieux. Vous poursuivez votre navigation dans cette ville qui s’offre à vous comme un livre d’images.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 3 — 02/05/2022
La ville est un jeu en construction. Les blocs s’alignent : cubes, trapèzes et parallélépipèdes rectangles où de tout petits humains courent pour y faire leurs affaires. Ils poursuivent frénétiquement ce qu’ils ont commencé lorsqu’ils étaient enfants. De nouvelles tours s’élèvent encore. Des grues grincent. Le verre crisse. Chantent les scies et les foreuses.
Un peu plus loin, l’ordre se désagrège. Une colline boisée et royale impose son pouvoir. Une première maison se décale et les autres suivent. Des trottoirs se lézardent. Le bêton vieillit. Les racines des arbres emprisonnés depuis trop longtemps dans de jolis squares victoriens, creusent inlassablement des échappatoires. Il suffit au promeneur de poser les pieds sur ces sillons secrets pour sentir la pulsion douce et puissante de la vie.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 2 — 01/05/2022
Nager au milieu des visages fatigués, se dissoudre dans le nombre, scanner son passeport, vider son sac. Puis suivre le parcours balisé par les magasins d’un luxe criard. Je ne suis plus qu’une référence prise en charge par des hommes et des machines qui fusionnent. Le douanier m’observe un bref instant avec un regard d’une froideur d’acier. Je range mon sourire et ma carte d’embarquement. Ensuite, j’attends en observant la lente chorégraphie des avions encore contraints à la terre et l’extrême lassitude des futurs passagers. Il faut une immense patience avant de prendre son envol pour avoir enfin la tête dans les nuages.

Chronique poétique d'un voyage à Montréal 1 — 26/04/2022
Le temps est venu. On se prépare. Il s’agit de montrer patte blanche en s’enregistrant numériquement. On a le bon profil. Politiquement très correct. Pas de casier judiciaire. Vacciné. Désinfecté. Jurant de poser le pied sur le sol canadien sans aucune mauvaise intention. On n’ose même pas la moindre pointe d’humour.
Alors, on s’occupe de la valise. Ce n’est pas rien. On veut emporter l’essentiel pour vivre deux mois loin de chez soi : le parfum de celles qu’on aime, le sourire et la musique des amis, les petites et grandes habitudes, les objets qui nous rassurent, la fidélité de son chien, la douce banalité du quotidien. Cela prend toute la place. On se rend compte bien vite qu’il est plus simple de ranger quelques chemises et de glisser entre deux pantalons, un carnet dont toutes les pages sont blanches. On se sent soudain incroyablement léger.
Départ prévu le dimanche 1er mai.

Et si les animaux nous rendaient moins bêtes — 06/04/2022
Parution d'un joli recueil collectif de nouvelles orchestré par Régine Vandamme, aux éditions Renaissance du Livre (Belgique).
Vous y trouverez mon hommage à Lupiote, ma chienne Jack Russel improbable.
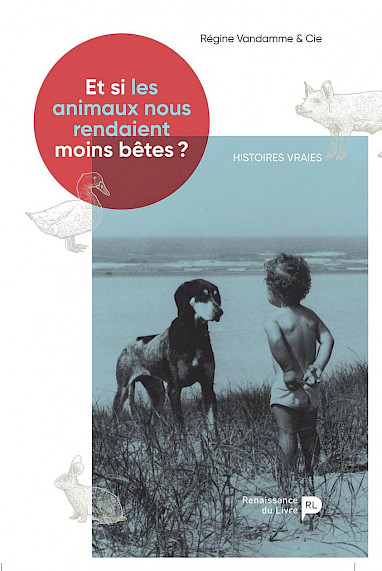
Salon des littératures singulières — 09/03/2022
Le dimanche 20 mars prochain, j'aurai le plaisir d'être présent avec les éditions Murmure des Soirs au Salon des littératures singulières, à Bruxelles. (Ecuries royales, rue Ducale, 1000 Bruxelles). L'occasion de vous rencontrer et de fêter les très beaux livres publiés par cette maison résistante. La fête commencera vers 11h et se terminera à 17h. Bienvenue !
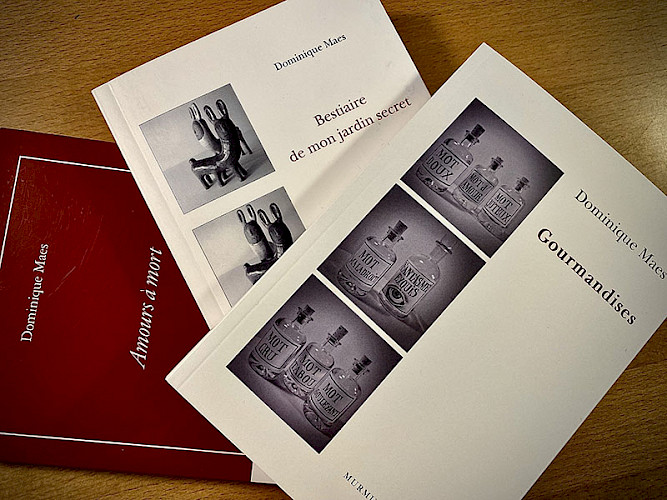
Bibliothèque de Babel — 08/03/2022
Mon dernier recueil de nouvelles est répertorié sur Babelio : https://www.babelio.com/livres/Maes-Gourmandises/1379440 et de bien jolis commentaires l'accompagnent.
Voilà qui fait plaisir. D'autant plus que les livres se font bien discrets en cette époque opaque. Ils me paraissent pourtant plus que jamais indispensables pour tenter de penser encore et fêter la vie. Résistance !
Gourmandises — 08/01/2022

Mon nouveau recueil de nouvelles est paru fin décembre 2021, aux éditions Murmure des Soirs (Belgique). C'est le quatrième livre qui naît en complicité avec cette maison d'édition résistante. Il faut désormais faire connaître ce nouvel opus. Quelques réactions positives émergent déjà dont ce très beau texte de Daniel Simon dans le Carnet et les Instants, revue de littérature belge publié par le Secteur des lettres de la Fédération Wallonie Bruxelles :
L’éditrice Françoise Salmon et l’auteur Dominique Maes ont bien eu raison de nous offrir en cette fin d’année une vingtaine de nouvelles autour du bonheur de la cuisine, de l’amour et de la littérature. En ces temps secs, c’est un bonheur de lire et relire certains passages de ce livre gouleyant, Gourmandises.
Dominique Maes a fait des études artistiques et a navigué, lors d’une déjà longue carrière, d’un archipel du récit à l’autre : écriture, dessin, illustration, conte… Il a été aussi nommé président directeur généreux de la droguerie poétique qu’il anime, construit et présente lors de ses multiples rencontres et expositions.
Si la gourmandise, dit-on sans y croire totalement, est un vilain défaut, capital même, Dominique Maes les cumule dans ce livre où les nouvelles s’enchaînent avec humour et finesse, entre l’amour de la cuisine et celui de la langue, celle des protagonistes, celle que nous parlons, celle qui nous habite. Les premiers récits de l’humanité ont probablement compté des recettes de cuisine. Le ventre avant les dieux !
Nous le savons de toutes les façons, la gourmandise est une fondation sur laquelle s’organise le cercle des plaisirs. Dominique Maes crée des situations où les personnages passent subtilement, goulûment parfois, de la table à l’amour et à la lecture.
L’auteur nous offre des nouvelles, où la dégustation brise la distanciation du temps (entre autres « Mochis »), et qui nous mettent en relation avec l’intime panoplie d’identités qui est la nôtre. La lecture de ses nouvelles nous met plus que l’eau à la bouche, parfois le vague à l’âme. La cuisine, le goût, l’odorat sont des souvenirs premiers, ceux de l’enfance. L’auteur plonge dans cet infini passé qui est en nous et organise dans un ordre rigoureux, qui est le travail de l’écrivain, des micros événements en mise en abyme des secrets et des jouissances que notre mémoire gourmande ne cesse de raviver.
Cuisine et littérature font bon ménage. Il est exquis de lire avec le nez, de goûter le suc des mots, et lorsque l’on déguste les nourritures terrestres, de chercher le langage qui a le temps qui intensifie encore en le nommant le plaisir ressenti.
L’odeur des livres neufs m’est nécessaire presque chaque semaine et lorsque je la capture dans une de mes librairies préférées, généralement en fin de matinée, elle m’ouvre tellement l’appétit que je ne puis faire autrement que de rejoindre, ma provision de nouveaux ouvrages sous le bras, l’un de ces jolis petits restaurants qui proposent leur plat du jour. J’adore ces repas assez rapides, en solitaire, où il m’est permis d’observer les habitués avaler le repas en riant, heureux de cette parenthèse dans une journée laborieuse.
(…)
Le plaisir est encore plus vif, lorsqu’il m’est possible de cuisiner et lire dans le même temps.
Ce ne sont pas des obsessions mais des mouvements qui animent les personnages comme de véritables tropismes, des attractions papilloactives. Elles nourrissent autant quelles brûlent…
L’auteur nous rappelle qu’on se met toujours à table avec des fantômes, de même que l’on écrit dans un univers d’anamorphoses. Rien n’est vrai évidemment, malgré l’obsession du temps de vouloir faire de la littérature une sorte de banc des accusés du réel, mais tout est juste quand on n’oublie pas, comme le fait Dominique Maes, qu’écrire c’est aussi commémorer ce qui reste en nous.
Les portraits de ces amoureux culinaires, tripoteurs de papilles et lecteurs au nez fin honorent la joie de vivre et de lire.
Daniel Simon
Faites vos voeux — 30/12/2021
Se laisser aller vers l’incertitude
en voulant encore se faire du bien
et le partager
bouleverser les habitudes
pour créer d’autres lendemains
croire en de nouvelles aventures
emprunter de nouveaux chemins
comprendre enfin
que l’on ne sait rien
de ce qui nous attend
dans quelques instants
mais oser prendre à bras le corps
cette vie qu’il faut goûter
encore,
encore,
encore...

Nouveau site — 20/12/2021
Tandis que cette année 2021, si particulière, se termine voici le début d’un nouveau cycle et la naissance d’un nouveau site !
Si la Grande Droguerie Poétique dont je suis désormais le Président Directeur Généreux à temps complet, poursuit son incroyable histoire, vous pourrez découvrir et suivre ici mes activités littéraires en expansion permanente, les dessins et les créations musicales.
Le site a été conçu par mon fils, Lionel Maes, que je remercie affectueusement.
En cette fin d’année j’ai la joie de vous annoncer la parution de deux nouveaux livres : "Pot Aime" qui rassemble les Poèmes et Chansons de la Grande Droguerie Poétique aux éditions Maelström Réevolution ainsi que "Gourmandises", nouveau recueil de nouvelles aux éditions Murmure des Soirs. Ils peuvent être commandés chez votre libraire préféré(e) ou directement sur le site des éditeurs.
Pour Gourmandises : https://murmuredessoirs.com/gourmandises.php
Pour les Chansons de la Grande Droguerie Poétique : https://www.maelstromreevolution.org/catalogue/item/755-chansons-de-la-grande-droguerie-poetique
Vous pouvez aussi découvrir ici une première intervieuw à propos de Gourmandises : http://www.canalzoom.be/invitvous-dominique-maes/
Quant à la Grande Droguerie Poétique, plus immobile pendant l'époque opaque que nous avons traversée, elle a préparé des lendemains qui enchantent et le Laboratoire Mobile s'apprête plus que jamais à sillonner les routes pour rencontrer les humains. Un nouveau site, en lien avec celui-ci, sera très prochainement mis en ligne.
En route pour de nouvelles aventures !